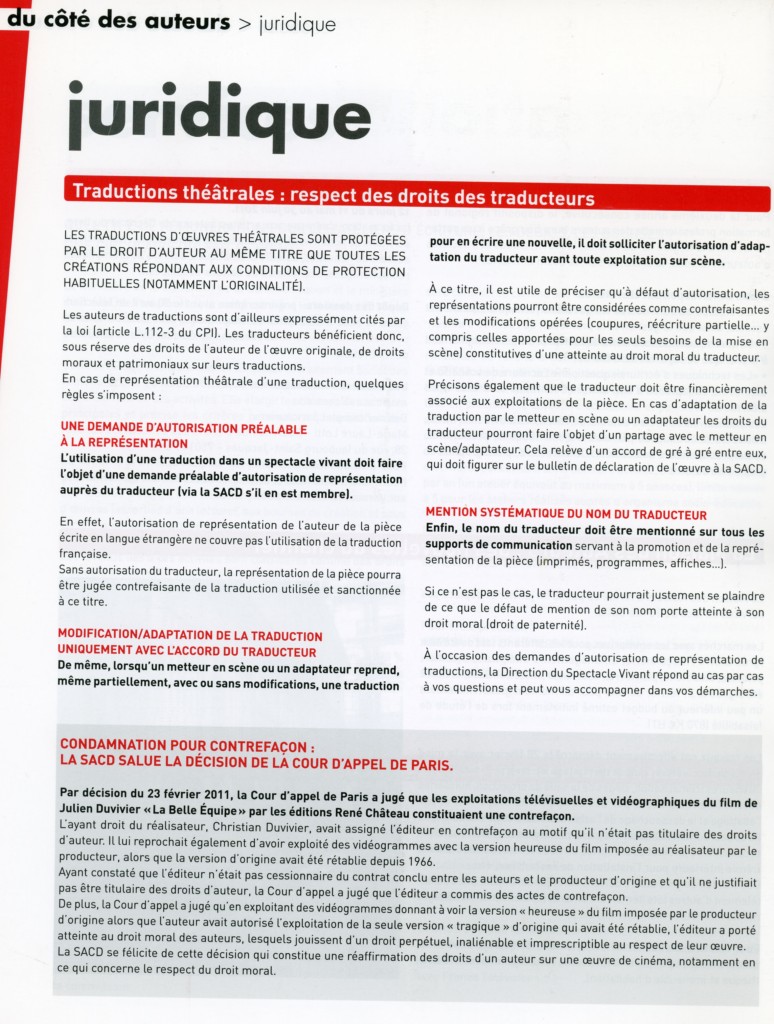.
Pour commencer, précisons qu’en tant que traducteurs, nous avons eu la chance exceptionnelle de commencer à travailler au théâtre avec des metteurs en scène particulièrement attentifs et soucieux d’interroger le texte : Antoine Vitez pour la traduction du Revizor de Gogol, puis Georges Lavaudant pour Platonov de Tchekhov, Stéphane Braunschweig pour La Cerisaie, Alain Françon pour La Mouette d’abord, puis la plupart des pièces de Tchekhov jusqu’à La Cerisaie que nous avons remise sur le métier à deux reprises avec lui. Nous avons, par la suite, travaillé avec de nombreux metteurs en scène et de nombreux comédiens qui nous ont permis d’améliorer notre texte — Claire Lasne-Darcueil, Mathias Langhoff, Jean-Louis Martinelli, Patrick Pineau, Jean-Yves Ruf, Claudia Stavisky, Claude Yersin… chacun a apporté sa touche à la version finale.
C’est au fil des répétitions et grâce au travail, non pas pour mais avec des metteurs en scène, que nous avons élaboré un texte qui, d’avoir été mis à l’épreuve de l’acteur, est devenu, au fil des années, plus précis parce que pensé en situation. Nous pouvons le dire sans forfanterie particulière puisque bien des répliques ont été trouvées par des comédiens, sur le plateau, et que bien des solutions à des problèmes que nous nous posions ont été trouvées lors du travail à la table.
Ayant appris au cours des années à nous fier à la mise en scène et à en attendre la possibilité d’améliorer notre travail, c’est tout à fait par hasard que nous avons découvert le problème du plagiat : au terme d’un stage avec des enseignants sur l’une de nos traductions, la directrice étant en retard, nous sommes restés regarder une captation d’une mise en scène. À notre grande stupeur, nous avons reconnu des passages entiers de notre traduction, mise en lambeaux et signée par le metteur en scène. Que faire ? Nous n’avons rien fait. Puis la situation s’est reproduite et nous avons alors, parce qu’il s’agissait de notre pièce préférée, La Cerisaie, et du directeur d’un théâtre subventionné sur fonds publics, décidé de réagir.
A commencé alors un étrange périple au pays du plagiat, périple assurément moins agréable que la traduction mais instructif à sa manière, et peut-être susceptible d’aider ceux qui sont victimes du système de contrefaçon organisé que nous avons découvert.
Nous allons donc essayer d’expliquer en quoi, la traduction théâtrale étant un exercice particulier, le plagiat au théâtre est lui-même particulier et devrait entraîner des réponses adaptées, ce qui est loin d’être le cas. Pour éviter de trop nous disperser, nous nous appuierons uniquement sur nos traductions de Tchekhov : elles nous ont valu nos premières et nos dernières découvertes tant dans le domaine de la traduction de théâtre que dans le domaine du plagiat.
*
TRADUIRE LE THÉÂTRE
C’est pour avoir découvert dès le début, grâce à cette première traduction de Platonov dans la mise en scène de Georges Lavaudant, voilà déjà dix-huit ans, que le théâtre ne peut pas se traduire en chambre que nous avons décidé de ne jamais publier une pièce qui n’ait été jouée ou, du moins, soumise à l’épreuve de l’acteur. De cela nous nous sommes convaincus au cours des années.
1. La traduction de théâtre : une traduction en situation
La meilleure illustration de cette constatation de base nous a d’ailleurs été offerte par les deux répliques qui ouvrent, avec cette pièce, tout le théâtre de Tchekhov :
— Chto ?
— Nitchevo…
Ce sont des répliques qu’il est possible de traduire même en n’ayant pris que trois leçons de russe :
— Quoi ?
— Rien.
Il est d’ailleurs prodigieux qu’un lycéen de dix-huit ans, écrivant une pièce jamais jouée de son vivant, ait trouvé cette réplique qui prend tout son théâtre en miroir — y compris cette pièce sur le rien qui devait suivre La Cerisaie. Nous avons traduit :
— Alors ?
— Rien…
Tous les traducteurs ont trouvé des solutions du même genre, avec une tendance à en rajouter, alors qu’il nous a semblé essentiel d’être bref. Mais traduire les mots était fausser le sens. C’est au cours d’un travail avec des élèves comédiens qui cherchaient à jouer la scène que cela nous est apparu, et pourtant personne ne nous avait jamais posé la question. La situation était pourtant claire : la générale, qui est le personnage le plus énergique de la pièce, est assise, le front penché sur les touches du piano. Le médecin entre, voit qu’elle est anormalement abattue, et lui demande, mais de manière détachée, légère :
— Qu’est-ce qu’il y a ?
La générale lui répond :
— Rien…
Et elle se met à plaisanter :
— On s’ennuyote…
On pourrait encore traduire :
— Ça va ?
— Ça va… On s’ennuyote…
Mais ce qui est extraordinaire est le fait d’avoir mis deux mots d’une telle banalité, tout à la fois contradictoires et en écho. Bref, il nous reste maintenant à trouver comment transposer ce qui porte les mots et leur fait dire ce qu’ils ne disent pas. Or, là est bien l’essentiel : le sens n’est pas une entité marmoréenne mais une cristallisation d’informations qui peuvent laisser transparaître autre chose que ce qui est énoncé. C’est de ce jeu intérieur, de cette zone de latence à l’intérieur même du texte que peut s’enrichir le jeu de l’acteur. Or, construire une interprétation qui permette au comédien de construire la sienne suppose parfois d’être très éloigné du mot à mot. Une vraie traduction se reconnaît précisément à cet écart, qui la rend aussi reconnaissable qu’une voix.
2. La traduction de théâtre : une écriture en collaboration
Il va de soi que le metteur en scène peut être d’une aide capitale pour permettre au texte d’émerger. Ce n’est là d’ailleurs qu’une constatation qui inscrit la traduction dans le prolongement du travail de Tchekhov lui-même : ses pièces ont été modifiées en fonction des exigences de Stanislavski, entre autres, et au contact des comédiens.
Dans le cas des traductions de Tchekhov, c’est d’abord grâce au long compagnonnage avec Alain Françon que nous avons pris le parti de traduire les pièces en revenant au manuscrit remis par Tchekhov à la censure. À l’origine, traduisant La Cerisaie, nous avions constaté que l’acte II, tel que Tchekhov l’avait d’abord rédigé, était beaucoup plus intéressant que l’acte II finalement écrit sur les conseils de Stanislavski. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé de traduire toutes les variantes de La Mouette pour la mise en scène d’Alain Françon ; nous les avions mises en note de bas de page ; Alain Françon nous a suggéré de les insérer dans le texte et nous avons vu émerger une pièce nouvelle, c’est-à-dire La Mouette telle que Tchekhov l’avait originellement écrite — une pièce plus longue, plus riche et plus mystérieuse… De ce travail en commun est venue notre décision de toujours revenir au manuscrit de censure et de publier la version originale et la version académique de chaque pièce. Ainsi les metteurs en scène français jouent-ils souvent un Tchekhov que les Russes ne connaissent pas. Même si elle n’est qu’un mal nécessaire, la traduction peut être une chance de renouvellement pour un auteur, pour peu qu’elle soit une forme d’écriture au sens plein.
La traduction est une œuvre seconde ou n’est rien, c’est une constatation simple : nous avons, en traduisant Tchekhov, fait des choix, cherché des correspondants à des motifs stylistiques qui relevaient d’un travail d’écriture personnel ; nous avons notamment essayé de respecter le réseau de ce que nous avons appelé les « motifs », ces mots qui passent d’un personnage à l’autre et font que tous, quand bien même leur langue est très différente de celle des autres, participent à un chœur ; cela, qui n’avait pas intéressé les autres traducteurs, s’inscrit dans une perception du texte comme trame. Si, comme pour tout travail littéraire, l’essentiel de nos intuitions nous reste obscur, il n’empêche que nous pouvons expliquer ces choix. C’est la raison pour laquelle après avoir traduit tout le théâtre de Tchekhov, nous avons peu à peu revu chaque traduction, le texte d’une pièce se précisant par celui des autres. Et c’est la raison pour laquelle enfin la traduction mène naturellement à traduire l’œuvre entière d’un auteur : le théâtre de Tchekhov ou de Synge est lisible comme un grand poème, et la traduction permet, ou, du moins, devrait permettre d’en restituer la trame avec cohérence.
Écriture seconde, mais écriture au sens plein, voilà ce qu’est la traduction. Le malheur est qu’elle n’est reconnue en France que comme une activité secondaire, voire vaguement frauduleuse (combien de fois nous aura-t-on répété « traduttore traditore »…) et c’est dans cette zone de latence que s’inscrit la pratique du plagiat.
*
PLAGIER LA TRADUCTION DE THÉÂTRE
1. Le plagiat
Nous n’allons pas nous lancer dans de longs développements sur la définition du plagiat, ses limites et son histoire. Néanmoins, il est intéressant de signaler que le mot n’est entré dans la langue française que comme dérivé du mot plagiaire, du latin plagarius désignant un voleur d’esclaves, terme lui-même dérivé du grec plagios, oblique : le terme, à l’origine, désigne une personne qui agit de côté, qui, par des manœuvres biaisées, agissant par contournement, s’empare du bien d’autrui.
La définition du plagiat souffre d’une ambiguïté que cette étymologie peut contribuer à éclairer : le plagiaire emprunte, détourne, imite et, par là, vole les écrits d’autrui. Il commet donc un délit : le Petit Robert définit le plagiat comme « vol littéraire ». Mais, oblique, la manœuvre qui consiste à copier autrui ou à l’imiter est aussi une forme d’hommage. Ainsi la notion d’imitation ouvre-t-elle toute une zone de flou qui semble mener à une certaine indulgence pour le plagiat. À parcourir les essais consacrés au sujet, on constate que la plupart des auteurs se croient tenus d’examiner si le plagiat ne se défendrait tout de même pas un peu ; il y a des écrivains pour, des écrivains contre, d’autres qui considèrent que toute la littérature n’est que plagiat, et le mot d’esprit stupide de Giraudoux, repris par le Petit Robert, est appelé à faire autorité : « Le plagiat est la base de toutes les littératures, excepté de la première, qui d’ailleurs est inconnue». Enfin, le plagiaire, victime de son inaptitude, n’est pas sans éveiller une sorte de pitié fraternelle ou confraternelle chez ceux qui se penchent sur son cas (ainsi Michel Schneider lui consacre-t-il un chapitre de son essai, Voleurs de mots, en le montrant, comme l’analyste « en proie à la passion du transfert »[1]).
Le propre de l’individu victime de plagiat est d’ailleurs de se sentir tout à la fois indigné, sans défense et légèrement coupable : il se trouve contraint de revendiquer ce qui lui appartient quand la notion de propriété littéraire est loin d’aller de soi et qu’il est agréable de penser que, dans le domaine de l’esprit, tout est à tout le monde.
Le plagiat n’a été juridiquement défini comme contrefaçon que fort tard mais, une fois la définition posée, le règne du flou a cessé : à présent, l’article L.335-3 du Code la propriété intellectuelle stipule qu’est « un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ». Or, le Code de la propriété intellectuelle (article L.121-1) est tout à fait clair à ce sujet : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».
Du fait que l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », utiliser sans autorisation un texte pour une représentation relève donc de la contrefaçon qui est passible de lourdes peines : la loi du 29 octobre 2007 stipule que les peines encourues pour le délit de contrefaçon peuvent aller jusqu’à trois ans de prison et trois cents mille euros d’amende…
2. Le statut de la traduction
Mais la traduction est-elle considérée comme œuvre au sens plein ? Juridiquement, oui : « La traduction n’est pas le résultat d’un processus automatique : par les choix qu’il opère entre plusieurs mots, plusieurs expressions, le traducteur fait une œuvre de l’esprit », écrit Claude Colombet[2], et la jurisprudence a rappelé que les traducteurs jouissent du droit à la paternité comme tous les autres auteurs[3].
De fait, les traducteurs de théâtre, amenés à adhérer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), sont considérés comme auteurs dramatiques, payant la cotisation annuelle et versant un pourcentage de leurs droits (généralement 13%) à cette Société, chargée de percevoir les droits que versent les théâtres. Ces droits correspondent généralement à 10 % de la recette. Pourtant, bien que les considérant théoriquement comme des auteurs au sens plein, la SACD prélève, en plus du pourcentage habituel, 10 % si les traducteurs ont procédé à une adaptation d’un texte en prose du domaine public et 20 % si le traducteur n’a fait que traduire une pièce de théâtre du domaine public (lequel est à présent porté à soixante-dix ans après la mort de l’auteur). Pour nos traductions de Tchekhov, la SACD prélève donc le tiers de nos revenus, sans plafonnement (ce qui n’est pas sans importance car un traducteur littéraire peut avoir la chance de traduire une pièce de théâtre qui connaît un grand succès une année et ne gagner ensuite que de faibles sommes).
Nous avons fait observer que cette situation était inadmissible, principalement pour les traducteurs qui n’ont pas d’autres revenus, et que la SACD était en contradiction avec ses propres statuts : les traducteurs sont des auteurs qui subissent un traitement particulier, et particulièrement défavorable. Il nous a été opposé trois arguments : tout d’abord, que la SACD s’appuie sur le principe de Victor Hugo « les morts payent pour les vivants »— argument irrecevable puisque des centaines d’auteurs français du domaine public sont joués sans que le moindre pourcentage soit prélevé ; ensuite, que les traducteurs se servent de la renommée des auteurs qu’ils traduisent et doivent donc payer pour les « vrais auteurs » — argument doublement irrecevable puisque des auteurs inconnus peuvent devoir leur renommée à des traducteurs connus et que les traducteurs ne sont pas de faux auteurs ; enfin, que le traducteur doit payer pour les créateurs car il ne crée pas : il crée un peu plus s’il adapte et le prélèvement supplémentaire n’est alors que de 10% mais le traducteur qui respecte le texte au plus près doit subir, lui, un prélèvement supplémentaire de 20%. Nous en revenons donc à cette incohérence fondamentale d’un auteur dramatique qui n’est, en fait, pas un auteur. Tous nos efforts pour nous faire entendre à ce sujet sont restés vains[4] et l’ultime réponse d’un membre du conseil d’administration de la SACD a été : « On ne va quand même pas défendre les traducteurs alors que les trois quarts des traductions sont bidouillées ».
Bidouillées… Ce n’était, bien sûr, pas une réponse officielle, mais nous nous en sommes souvenus à maintes reprises quand nous sommes entrés dans l’univers obscur du plagiat.
*
UN SYSTÈME INSTITUTIONNALISÉ
Constatons pour commencer que nous traduisons Tchekhov depuis vingt ans, que nous avons traduit plus d’une centaine de pièces et participé à une centaine de mises en scène ; nos traductions ont presque toutes été publiées, ce qui est un atout considérable pour en établir l’antériorité. Or, en vingt ans, nous n’avons pas souvenir que la SACD nous ait signalé le moindre problème d’utilisation de notre nom. Nous vivions donc dans un monde étranger au doute lorsque, courant 2008, nous avons vu que nous étions annoncés comme traducteurs de La Cerisaie au théâtre Sorano de Toulouse. À un endroit du site Internet du théâtre, du moins, le texte était donné comme le nôtre (chose étrange, dans la version de 1992, que nous avions entièrement refaite depuis) et à un autre endroit comme celui du metteur en scène et directeur du théâtre, Didier Carette, subitement devenu traducteur du russe. Cependant, les citations données sur le site provenaient exclusivement de notre traduction. Nous avons décidé d’en avoir le cœur net.
.
1. À la découverte du plagiat
Un auteur non dramatique plagié n’a, en somme, qu’à se pourvoir d’un surligneur fluo et d’un bon avocat : il surligne les passages semblables et le juge constate. L’auteur dramatique, lui, dans sa candeur, commence par se dire qu’il suffit de demander à la SACD si le texte déposé est le sien ou non. Toute traduction doit faire l’objet d’un bulletin de déclaration indiquant le ou les auteurs, puis, normalement, être déposée pour que la SACD décide du pourcentage à prélever. En l’occurrence, à quelques jours de la première, le texte n’était toujours pas déposé, mais le bulletin de déclaration indiquait que la traduction était celle du metteur en scène.
Pour savoir si le texte était plagié, il suffisait, nous semblait-il, de demander à la SACD de nous le communiquer pour le comparer au nôtre. Nous avons donc attendu que le texte soit déposé. Mais, première surprise, le texte ne pouvait être communiqué qu’à la requête d’un juge, donc dans le cadre d’une procédure en contrefaçon. Et comment établir qu’il y avait contrefaçon puisque le texte n’était pas communicable ? La SACD pouvait-elle comparer notre traduction déposée de longue date et celle du metteur en scène ? Non plus. La SACD se contente de reverser les droits après avoir décidé du prélèvement à percevoir pour ses services.
Mais elle dispose justement d’un service juridique…
Le service juridique a produit un texte, disponible en ligne, et intitulé « Auteurs de spectacle vivant : que pouvez-vous faire face à la contrefaçon de votre œuvre »[5], texte destiné à guider l’auteur dramatique :
« En cas de plagiat, il convient de lister les ressemblances caractéristiques entre les deux œuvres. L’envoi d’une lettre simple au responsable de l’exploitation litigieuse (producteur du spectacle par exemple) en vue d’un règlement amiable du litige peut être une première étape. Si ce courrier n’est pas suivi d’effet, vous pouvez adresser une lettre recommandée avec avis de réception au responsable de l’exploitation litigieuse et/ou à l’auteur de la contrefaçon en mentionnant l’existence d’un constat d’huissier s’il a été établi au moment de l’exploitation. Au cas où le règlement amiable n’est pas envisageable, vous pouvez saisir la justice pour obtenir réparation. Il vous faudra alors recourir aux services d’un avocat qui, dans un premier temps prendra contact avec l’avocat de l’auteur de la contrefaçon pour proposer une issue transactionnelle. Si celle-ci est impossible, il conviendra d’assigner l’auteur de la contrefaçon afin d’obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi. »
Ce texte semble inviter l’auteur à faire d’abord un courrier simple au plagiaire pour lui demander s’il est bien plagiaire ; puis, en cas de réponse positive, à lui adresser un courrier recommandé avec accusé de réception pour envisager un règlement amical ; et, enfin, en cas de refus non amical, d’avoir recours soit à un avocat, soit au service de médiation de la SACD. Avant de faire le moindre courrier, nous avons considéré qu’il nous fallait d’abord savoir quel texte était joué. On nous a suggéré d’envoyer quelqu’un l’enregistrer. Entre-temps, les représentations ayant commencé, nous avons obtenu par des amis de Toulouse une copie de la brochure remise aux comédiens. Nous avons donc su que c’était bien notre texte qui était joué, mais, selon l’expression du responsable de la SACD, « bidouillé », c’est-à-dire mélangé à des morceaux d’une autre traduction et travesti par des contresens.
Nous avons consulté un avocat qui nous a expliqué que les conseils de la SACD avaient rendu l’affaire implaidable : il fallait, en effet, commencer par faire un constat d’huissier ; le seul élément à retenir des conseils de la SACD était : « …en mentionnant l’existence d’un constat d’huissier s’il a été établi au moment de l’exploitation ». Sans constat d’huissier, nulle preuve…
Cependant, la SACD indiquait aussi qu’il était possible de recourir à l’un de ses agents assermentés : « Il vous est conseillé de faire établir un constat d’huissier ou une constatation par les agents assermentés d’une société de gestion collective ». Hélas, nouvelle révélation : l’agent assermenté de la SACD n’intervient pas. Pour quelle raison ? Il ne nous a pas été possible de le comprendre.
D’après notre avocat, pour obtenir gain de cause, il fallait assigner la SACD d’abord et le metteur en scène ensuite…
Nous avons, pour finir, fait appel à une avocate qui a repris le dossier et a mené brillamment la transaction sur les bases que nous souhaitions : notre but n’était pas de gagner de l’argent mais de mettre enfin sur la place publique un problème voué à se poser de manière récurrente. Nous avons donc obtenu de placer sur le site du théâtre Sorano une lettre ouverte exposant les faits1.
LETTRE OUVERTE
Au cours de ces dernières années, nous avons constaté qu’une pratique illégale tendait à se répandre en toute impunité : des metteurs en scène prenaient des traductions, les modifiaient à leur guise, les déclaraient sous leur nom à la Société des auteurs dramatiques et touchaient les droits d’auteur.
Nous avons décidé de réagir chaque fois que nous le pourrions, non d’abord pour défendre nos droits, mais pour défendre le travail de traduction comme œuvre au sens plein, rédigée dans le respect de l’œuvre originale, et ne pouvant être frauduleusement modifiée sans porter atteinte à l’intégrité de ce travail et de cette œuvre.
Ayant appris que le théâtre Sorano présentait La Cerisaie de Tchekhov et annonçait tout à la fois que le texte était publié dans notre traduction aux éditions Actes Sud et que la traduction était signée du metteur en scène et directeur du théâtre Sorano, nous avons eu la preuve que notre traduction était utilisée sans notre autorisation, après avoir été gravement altérée.
Une assignation a été délivrée le 25 juin 2008 pour contrefaçon.
Notre but n’étant pas d’obtenir une condamnation devant les tribunaux, mais de poser ouvertement un problème qui nous concerne tous, auteurs, traducteurs, spectateurs, metteurs en scène ou responsables culturels, nous avons accepté une transaction amiable et rédigé cette lettre de mise au point afin que le plagiat cesse d’être toléré, admis, voire encouragé par un silence complice.
André Markowicz et Françoise Morvan
Cette lettre ouverte venait d’être mise en ligne lorsque nous avons été invités par les étudiants de l’École normale supérieure de Lyon qui faisaient pour Alain Françon un dossier dramaturgique sur La Cerisaie. Ils devaient assister le soir à une représentation d’un spectacle intitulé Notre Cerisaie et nous ont invités à les accompagner. Aucun nom de traducteur n’était indiqué, le spectacle tournait depuis déjà longtemps et semblait avoir du succès. De fait, la salle était pleine. Il ne nous a pas fallu longtemps pour constater que c’était à nouveau notre texte qui était joué, mélangé avec des bouts d’autres traductions.
Interrogé à ce sujet à la sortie du spectacle, le metteur en scène en a convenu, c’était à 70% notre texte… « Mais c’est que votre traduction est tellement mieux ! » Alors pourquoi la truffer d’emprunts à d’autres traductions ? « Mais c’est que, nous, nous travaillons par strates ! » Par strates ? Oui, par strates successives, le texte évoluant jour après jour. Et pourquoi ne pas nous avoir demandé notre autorisation de jouer notre texte ? « Mais c’est que nous pensions le faire une fois le texte rendu définitif ! » Autant dire jamais, vu la méthode des strates.
Il s’agissait dans les deux cas de directeurs de théâtres, recevant de l’argent public : pas un seul organisme de tutelle, pas un seul journaliste, pas un seul responsable culturel n’avait posé de question au sujet du texte. Au contraire, les critiques étaient plutôt élogieuses. Le texte de Tchekhov était d’abord celui du metteur en scène et prendre une traduction ou une autre était indifférent puisque la traduction n’est qu’un laisser passer modifiable, échangeable, réductible à ce qu’on veut lui faire dire.
Le problème n’est pas d’abord la malhonnêteté du procédé — un metteur en scène faisant passer le texte sous son nom pour toucher les droits, l’autre ne le déclarant pas pour ne pas verser de droits — mais le fait qu’il est permis, voire encouragé, par tout un système.
2. Le plagiat encouragé
Si l’auteur d’un roman ou d’un essai plagié se trouve contraint de perdre du temps à se défendre et affronter l’univers aride des tribunaux, il lui est néanmoins assez facile de faire la preuve. Ainsi Michel Le Bris, Irène Frain, Henri Troyat, Jacques Attali, Patrick Poivre d’Arvor et tant d’autres ont-ils été condamnés pour plagiat, alors même qu’ils bénéficiaient des avocats de leurs éditeurs et de l’appui de leur renommée[6]. Ils ont été condamnés, il faut le constater, sans que cela semble nuire à leur image et surtout sans que cela mette en cause une pratique de la littérature dont ils ne sont que les vecteurs. Le traducteur d’une œuvre dramatique plagiée se trouve, lui, seul face à des difficultés presque insurmontables puisqu’il lui faut obtenir la preuve que c’est bien son texte qui est joué, puis mandater un huissier pour le constater, procédure ruineuse ouvrant sur de longs mois de procès à l’issue incertaine …
D’une part, l’indifférence à la traduction, l’absence de prise en compte de ce travail, aussi bien dans l’enseignement que dans les écoles de théâtre et dans la société en général, incite à faire du texte traduit un matériau informe, dont chacun peut s’emparer à sa guise ; d’autre part, le règne du metteur en scène, seigneur et maître détenteur du pouvoir ultime, l’invite à faire du texte sa chose ; le dispositif de perception des droits lui permet de déclarer en toute impunité un texte plagié et d’obtenir le règlement des sommes perçues par la SACD : au traducteur de faire jouer l’arsenal juridique en dépit des obstacles qui lui sont opposés. Ainsi comprend-on que la pratique du plagiat se généralise.
Depuis que nous avons commencé de nous intéresser au problème, nous avons constaté que nos traductions étaient utilisées par de jeunes metteurs en scène qui n’étaient pas même conscients de se rendre coupable de contrefaçon. Aucun des metteurs en scène qui s’étaient emparés de notre texte n’a, du reste, essayé de nier : ce qui nous a surtout frappés était l’unanimité dans l’aveu, ou plutôt la sérénité dans l’absence d’aveu. Le plagiat aurait pu être beaucoup plus malhonnête, le metteur en scène déformant systématiquement le texte pour y introduire des variations — c’est ce que nous avions constaté en regardant avec nos professeurs stagiaires la captation dont nous avions parlé au début. Il n’est que la conséquence d’un dispositif d’ensemble.
Nous avons proposé des solutions institutionnelles — il suffirait que la SACD mette à la disposition de ses membres l’exemplaire du texte du spectacle tel qu’il est déposé avant la première ; ce ne serait ni bien compliqué ni ruineux ; il suffirait que les agents assermentés procèdent à l’enregistrement du spectacle en cas de litige, ce qui n’est pas bien compliqué non plus (et qui est prévu par le texte du service juridique) ; dès lors que des traducteurs versent le tiers de leurs revenus à la SACD, il semble légitime qu’ils bénéficient en retour d’une protection adaptée.
Malheureusement, comme nous l’avons indiqué, ces remèdes ont été rejetés par la SACD, le refus de faire intervenir l’agent assermenté étant justifié par l’impossibilité d’intervenir pour un membre contre un autre, impossibilité totalement factice puisque l’agent se bornerait à faire en enregistrement. Quant au dépôt du texte numérisé, il ne coûterait rien et le texte n’occuperait aucune place. Ce refus est donc à interpréter comme approbation d’une dérive induite par les metteurs en scène qui ont fini par obtenir (de manière tout à fait abusive) d’être considérés comme auteurs, et membres à ce titre de la SACD.
Si des mesures étaient prises, et si un travail d’information était effectué dans les écoles de théâtre et les universités, il est certain qu’une normalisation des pratiques s’ensuivrait ; mais ces solutions ne changeraient rien au problème de fond qui est la persistance en France du mythe hugolien du poète par la voix de qui parle Dieu, les faux auteurs que sont les « adaptateurs » (puisque les traducteurs sont parés de ce nom, supposé moins humiliant) devant payer pour les vrais, comme on l’a vu ; mais ces statuts ne sont eux-mêmes qu’une conséquence du mépris où est tenu le travail du texte, et là est bien, nous semble-t-il, le point essentiel : l’indifférence à la forme qui fait qu’un traducteur français trouve normal de faire des alexandrins de treize syllabes, ou aussi bien quatorze ou quinze, au nom du naturel, va de pair avec l’indifférence à la matérialité du texte.
Le plagiat est possible, non d’abord parce que des personnes peu scrupuleuses veulent toucher les droits mais parce que le texte n’existe pas : s’il est possible de mêler les traductions, de les brouiller et de les déformer, comme de traduire des sonnets en prose ou en vers informes sans provoquer la moindre question, c’est que la forme n’est plus perceptible ; libre à chacun de faire ce qu’il veut, quitte à prendre à autrui ce qui n’est que simple prétexte. Amener à réfléchir au problème du plagiat est aussi amener à réfléchir à ce problème beaucoup plus vaste.
[1] Michel Schneider, Voleurs de mots, Gallimard, collection Connaissance de l’inconscient, 1985, p. 125. Ce chapitre fait suite à chapitre intitulé « Éloge du pillage ».
[2] Propriété littéraire et artistique et droits voisins, § 58, p. 45.
[3] Cour d’appel de Paris, 20 janvier 1999.
[4] Quoique pas totalement puisque le pourcentage de la retenue au titre du domaine public était, avant que nous ne soulevions le problème, de 20% pour les adaptations et de 30% pour les traductions, en sorte qu’un traducteur versait près de la moitié de ses revenus à la SACD… Au cours du colloque « Mise en scène et droit d’auteur », trois réponses nous ont été faites, à savoir qu’il s’agissait d’un problème personnel (ce qui n’est pas le cas), que la SACD avait à gérer quarante quatre mille dossiers par an (ce qui n’est pas une excuse) et que nous pouvions démissionner (ce qui n’est pas une manière de résoudre la question). Une entrevue à ce sujet nous a été proposée ensuite et nous avons évoqué avec la direction de la SACD le problème du plagiat (et celui du statut de la traduction). Nous avons proposé deux solutions : soumettre chaque texte traduit à obligation de dépôt sous forme de fichier ou de manuscrit, consultable sur demande écrite communiquée au traducteur ; permettre à un agent assermenté de faire un enregistrement du spectacle en vue de faire la preuve du plagiat. Après de longs mois d’attente, nous avons reçu un courrier de la SACD écartant ces deux solutions et nous invitant à nous inscrire à la Maison Antoine Vitez ou l’Association des traducteurs littéraires de France afin de bénéficier d’une protection juridique…
[5] Il est à noter que le texte a été modifié suite à la parution de cet article.
1 Lettre ouverte placée sur le site du théâtre Sorano durant six mois (http://www.theatresorano.com/accueil-b) sans avoir apparemment provoqué la moindre prise de conscience de la part de quiconque, subventionneurs ou simples spectateurs.
[6] Voir à ce sujet, les essais d’Hélène Maurel-Indart et, notamment, Du Plagiat, PUF, 1999 (édition augmentée et réactualisée en Folio Essais), ainsi que son site http://www.leplagiat.net
Remarquablement informé aussi, le site de Jean-Noël Darde « Archéologie du copier-coller ». On pourra constater l’extrême difficulté de combattre le plagiat à l’université, et le cynisme de certains plagiaires soutenus par l’institution.
A lire notamment :
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-noel-darde/020614/universite-paris-8-lethique-en-folie
http://archeologie-copier-coller.com/?p=12150
.
© Françoise Morvan et André Markowicz
Ce texte est paru dans les Actes du colloque Mise en scène et droit d’auteur, sous la direction de Sophie Proust (éditions L’Entretemps, 2012).
*
Je donne ici en fac-similé à titre complémentaire le texte publié par la SACD après notre intervention, notre rencontre et sa décision finale de ne pas intervenir pour mettre en œuvre les solutions que nous avions proposées. C’était en 2011… De l’art de rappeler les bonnes pratiques sans rien faire pour qu’elles soient respectées.
.
*
On pourra voir que la situation ne s’est pas améliorée et que des metteurs en scène continuent de plagier des traductions, et en ayant à l’occasion le soutien d’universitaires qui voient là un aimable remix. L’article d’André Markowicz « Tchekhov-remix » que j’ai mis en ligne ici a été très lu mais n’a provoqué aucune prise de conscience des tutelles : plagiaire ou pas, le metteur en scène bénéficie d’une impunité totale. Le plagié est donc, de toute façon, victime puisque la seule solution est de perdre du temps à assigner le plagiaire. Lequel, même lourdement condamné, se présentera comme victime, le règne du remix imposant ses lois.