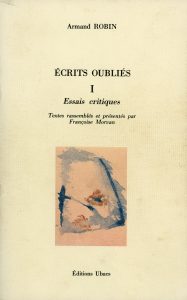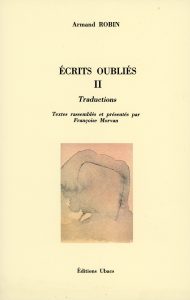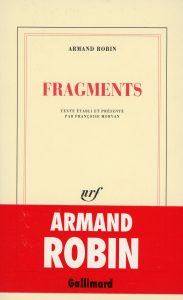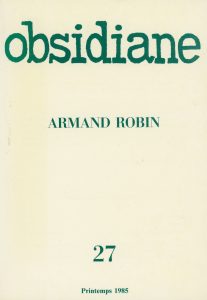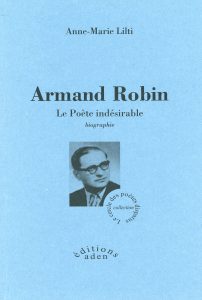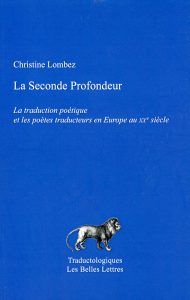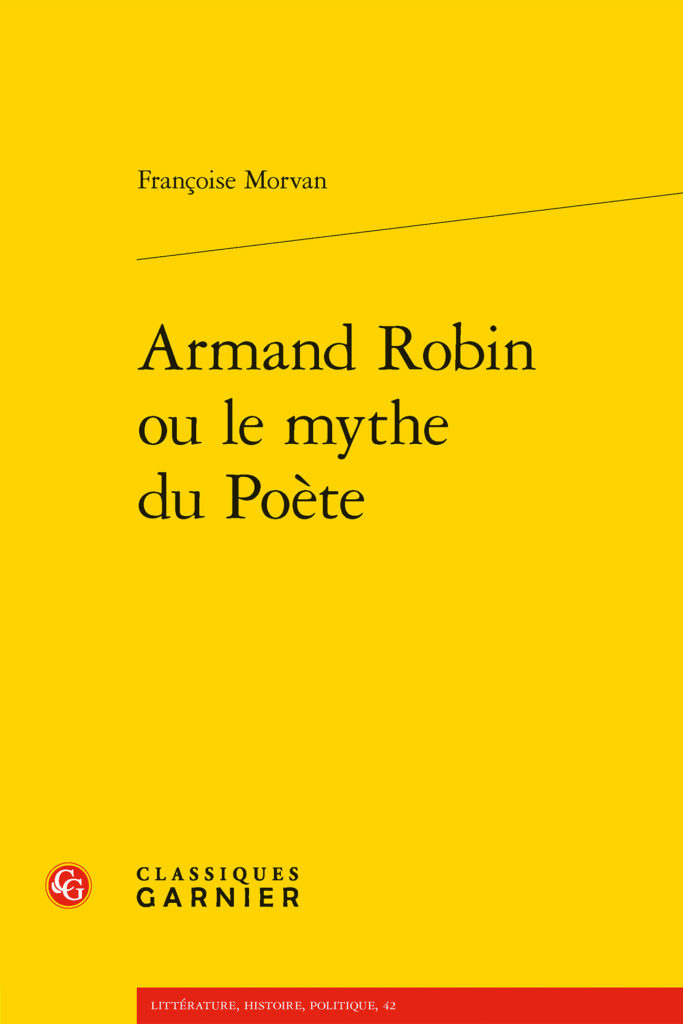.
« Aujourd’hui, mieux que jamais, je sais : je n’étais pas là et donc on ne pouvait obtenir nouvelle de moi. »
Armand Robin, « L’Homme sans nouvelle »
.
J’ai passé de longues années à chercher, rassembler, publier les textes d’Armand Robin et j’ai même soutenu une thèse de plus de deux mille pages sur cet auteur, ou plutôt ce non-auteur, qui s’était lancé dans une expérience littéraire hors normes.
Il me semblait que donner les textes sans les falsifier, montrer la manière dont la traduction avait pu être détournée pour donner lieu à une sorte d’épopée cosmique, publier les émissions de poésie et mettre en contexte l’étrange expérience d’écoutes radiophoniques était de nature à en finir avec la prolifération de commentaires enlisant Robin sous une mythobiographie fabriquée à partir de ce qui était, somme toute, un faux, à savoir Le Monde d’une voix. C’était une erreur. Ce que l’institution littéraire appelait, c’était Le Monde d’une voix et le Poète fabriqué par l’éditeur, doté de la vie adéquate, appelant le mythe requis, le tout rassemblé en une création assez solide pour faire bloc contre les faits.
Démontrer que Le Monde d’une voix avait été taillé à coups de ciseaux dans des manuscrits dérobés aux éditions Gallimard, manuscrits qui, enfin restitués, laissaient apparaître un ensemble intitulé Fragments par Robin lui-même me semblait de nature à ouvrir une perspective nouvelle sur cette expérience de dépossession de soi par la traduction. Mais non. Ce n’était pas de ça que l’institution littéraire avait besoin : il lui fallait un Poète, un poète martyr, un poète anarchiste, un poète traducteur, un poète sacrifié à son génie des langues, un poète breton, un poète rebelle, proscrit, martyr, braconnier, contrebandier, bref, un poète indésirable, et à fabriquer à partir de tous les lieux communs attendus pour être ainsi rendu parfaitement désirable, rentable, présentable dans les cercles de poètes et les colloques universitaires.
*
Pendant des années, donc, j’ai recherché les textes d’Armand Robin, je les ai publiés, accompagnés d’explications sur leur provenance et leur place dans un itinéraire atypique, en tenant compte du fait que, de fait, comme il l’écrivait, Robin n’existait que dans la mesure où il n’existait pas, ce qu’indique son texte testamentaire « L’Homme sans nouvelle », donnant son sens à ce qu’il a nommé « non-traduction ». Simple constat impossible à faire entendre : il faut, qu’on le veuille ou non, en passer par le dogme hérité du romantisme — un poète, c’est un poète ; seuls les poètes peuvent traduire des poètes ; les poètes ont des vies qui sont des vies de poètes et même s’ils n’ont pas écrit de poèmes, ils sont poètes avant d’être poètes. Nascuntur poetae, tout ça va de soi. Faire entendre le contraire, c’est porter atteinte au dogme, et il se trouve toujours tout un petit personnel pour réparer, consolider le dogme, conforter les certitudes et rassurer, non sans profiter au passage des mérites du poncif. Ainsi Robin, qui avait voulu fuir ce qu’il appelait la « poésie pour poètes », devient-il un prête-nom, un faire-valoir pour mauvais poètes, un martyr de la poésie considérée comme manifestation du sacré, un sacré jouant à bon compte son rôle de substitut de la religion.
C’est dans ce cadre idéologique que se situe le plagiat, et je voudrais montrer, à partir de mon expérience, comment les mécanismes de la contrefaçon se mettent en place pour servir un artefact d’autant plus essentiel à maintenir que chacun sait bien qu’il est faux (et nous sommes bien là dans une variante du « monde comme si »). En l’occurrence, toute l’institution, dès lors qu’un discours dérangeant se fait jour, se mobilise pour le rendre inaudible et le phagocyter. Au terme de la phagocytose, reste, plus gros, plus envahissant, plus triomphal dans sa vérité révélée, le produit du dogme, le Poète, ce christ que nous attendions tous (je ne fais là que citer l’éditeur du Monde d’une voix), christ anarchiste, s’il le faut, royaliste, s’il le faut, d’extrême gauche, d’extrême droite, selon les nécessités. Peu importe ce qui en est dit, l’important est que tout vienne enfler la mythobiographie destinée, elle, à faire sens et nourrir l’image du Poète.
Exposer les faits ne sert à rien ; publier les textes ne sert à rien ; bien au contraire, les faits peuvent venir nourrir la biographie, et les textes peuvent être exploités de manière à venir l’engraisser encore. Sur ce vient se greffer un discours universitaire destiné à légitimer la transformation opérée, fût-ce par cette phagocytation stupide qu’est le plagiat — pratique normalement condamnable mais que l’institution encourage.
C’est ce que je vais m’efforcer de démontrer en rappelant tout d’abord à quoi visait le travail d’édition des textes d’Armand Robin entrepris voilà déjà longtemps ; puis la manière dont peu à peu il a été détourné ; et enfin l’officialisation de la contrefaçon.
*
Comme ce texte est un peu long, je vais, une fois n’est pas coutume, en donner le plan pour commencer :
I. UNE LONGUE RÉSISTANCE
- Une première contrefaçon
- Donner à lire un autre auteur
II. FALSIFICATIONS
- Le Poète en pied
- Méthodologie du plagiat
- La fabrique de l’œuvre
III. OFFICIALISATION DU MYTHE
- Robin célébré national
- L’écrasante lourdeur du poncif
- L’officialisation du plagiat
*
.
.
I. UNE LONGUE RÉSISTANCE
J’ai découvert l’œuvre d’Armand Robin quand j’étais lycéenne, pendant mes vacances à Rostrenen, d’où il était, lui aussi, originaire.
Le seul livre disponible à l’époque était Ma vie sans moi suivi de Le monde d’une voix, paru dans la collection « Poésie-Gallimard ». L’éditeur et préfacier, Léon, dit Alain, Bourdon, avait rédigé une notice chronologique qui déroulait un itinéraire de poète anarchiste mort dans un commissariat martyr de ses convictions — un poète qui écoutait les radios du monde entier pour combattre les propagandes et qui traduisait les poètes du monde entier, sacrifiant sa propre poésie à la traduction, mais qui — ce nommé Bourdon l’assurait en préface — avait écrit peu avant sa mort tragique des poèmes retrouvés par miracle et Le monde d’une voix en était l’édition.
.
.
- UNE PREMIÈRE CONTREFAÇON
Cette biographie de poète maudit avait tout pour séduire une lycéenne rebelle et crédule comme tant d’autres — crédule, je l’étais, mais il faut bien constater que les critiques les plus autorisés s’y sont, eux aussi, laissés prendre. Contrairement aux critiques autorisés, je me suis d’ailleurs tout de même interrogée d’entrée de jeu sur Le Monde d’une voix. Comment expliquer la présence dans ce volume de poèmes très beaux et d’autres si étonnamment faibles ? Et comment expliquer que du premier recueil de Robin, Ma vie sans moi, composé en miroir de poèmes personnels et de poèmes traduits, l’éditeur ait supprimé toute la partie traduite ?
C’est d’abord cette énigme qui m’a intriguée, puis le fait qu’Alain Bourdon (que, dès la rentrée, j’avais rencontré à Paris) considérait les bulletins d’écoutes qu’il possédait comme secondaires et ne les communiquait qu’au compte-gouttes, sous surveillance. Ce qui m’intéressait dans l’œuvre de Robin, c’était justement cette ouverture de la poésie sur la politique et cette manière de sortir de la poésie, de refuser de produire une œuvre poétique conforme. Sortir de la poésie, sortir des formes conventionnelles, et du roman, et de la critique, c’était mon but. Et Robin ouvrait une porte sur la traduction qui permettait aussi de sortir du confinement dans la vieillerie poétique.
Je me suis vite rendue compte que la Société des Amis d’Armand Robin créée et présidée par Alain Bourdon lui servait d’abord à se promouvoir et promouvoir une idée tout à fait fausse du travail d’Armand Robin : son activité consistait précisément à tout rabattre sur une œuvre poétique aussi conforme que possible, Le Monde d’une voix faisant office de vérité ultime. Pour Bourdon, Robin était une occasion de mondanités diverses, entretiens chez les Jésuites, salons, colloques, conférences, bref, toute une activité de littérateur qui me semblait la trahison de ce Robin qu’il prétendait servir.
Se disant sans vie, Robin avait produit une œuvre — ou plutôt une non-œuvre — immense, passant par Imroul’qaïs, Essénine, Maïakovski, Pasternak, Ady, Wang Wei… le chinois, le hongrois, le russe, l’arabe, le tchérémisse des prairies… au total, vingt langues. Mais on se contentait de vanter les géniales traductions du Poète, traductions qui n’avaient pourtant d’intérêt que dans la mesure où elles étaient tout autre chose.
L’expérience d’écoutes radiophoniques était, elle aussi, rendue incompréhensible, les bulletins d’écoute n’étant pas communiqués : de ce travail qui avait occupé l’essentiel du temps de Robin, il suffisait de retenir qu’il s’agissait d’un regrettable sacrifice du Poète à la lutte contre les propagandes.
Enfin, alors que Robin s’était voulu sans vie, et que cette expérience poétique qu’il disait lui-même « antibiographique » valait justement comme dés-œuvrement, les « amis d’Armand Robin » délayaient sans fin la même biographie revue et corrigée. Je ne savais pas alors qu’elle était fabriquée, mais je savais que ces lieux communs biographiques étaient en soi, eux aussi, une trahison — appuyant, qui plus est, l’absence de recherche des textes, la Vie de Poète faisant saturation.
J’ai commencé par soutenir un mémoire de maîtrise sur Armand Robin, pour exposer une situation qui me semblait d’ores et déjà problématique, puis j’ai réédité La fausse parole. C’est à l’occasion de cette réédition, accompagnée de la reproduction en fac-similé de bulletins d’écoute et de textes complémentaires de Robin sur cette expérience d’écoutes radiophoniques, que j’ai constaté l’invraisemblable situation de blocage dont souffraient les manuscrits de Robin — et notamment les manuscrits qui avaient servi à faire Le Monde d’une voix.
Comment expliquer que les manuscrits de Robin, recueillis après sa mort par Claude Roland-Manuel et Georges Lambrichs, et par eux déposés aux éditions Gallimard, se trouvaient chez Alain Bourdon qui refusait de les restituer ? De quel droit ? Le romancier Henri Thomas me l’avait expliqué : il avait emmené Bourdon prendre les manuscrits dans les caves de Gallimard où se trouvaient les archives et ils avaient entrepris d’en donner une première édition, pour laquelle il avait rédigé une préface, puis une deuxième, confiée au seul Bourdon, ainsi bombardé spécialiste en titre.
Le premier Monde d’une voix était peut-être admissible — la préface d’Henri Thomas était tout au moins neutre. Le second ne l’était plus, et d’ailleurs, les textes avaient été rebrassés comme au hasard, donnant lieu à une monstruosité éditoriale : la première partie du premier livre de Robin, Ma Vie sans moi, sans la partie traduite qui lui donnait son sens, servait à cautionner une nouvelle mouture du Monde d’une voix, suivie d’une notice bio-bibliographique comportant autant d’erreurs que de lignes mais orchestrant le mythe du Poète maudit. Le tout était précédé d’une préface en prose assonancée exposant les inepties qui allaient faire florès. Spécimen de la prose bourdonnesque :
« Pour tenter la trouée, tous les moyens sont bons !
Quelquefois le danger est si grand, si grande est la perversion que le poète, en perdition, n’a plus d’autres munitions qu’invectives et jurons. Les Poèmes indésirables sont le dernier bastion où, tremblante d’indignation, sa voix gronde et s’enroue en imprécations.
Mais plus souvent, même aux plus périlleux instants, quand brouillé en “brouillon”, “recouvert de limon”, enseveli en “boue et labour”, il semble retourné au chaos, une inspiration subite lui dicte sa stratégie, renverse les positions, lui assure la suprématie d’une souveraine ironie, et de faiblesse engendrant malice, le poète soudain surgit, rétabli dans une noblesse infinie… »
Et c’est Gallimard qui publie (et republie) ça.
Si Ma Vie sans moi suivi de Le Monde d’une voix est une contrefaçon, c’est d’abord parce que jamais Robin n’a écrit de volume intitulé Le Monde d’une voix — titre qui, en soi, est un contresens —, ensuite parce que Robin n’a pas produit à la fin de sa vie une œuvre poétique sauvée du sacrifice christique à la traduction, enfin parce que le livre a été fabriqué en coupant les manuscrits à coups de ciseaux pour séparer tout ce qui était vers de ce qui était prose. Cela, j’ai pu le constater, bien longtemps après, quand, à la suite des courriers de Robert Gallimard et de Georges Lambrichs, Bourdon a fini par rendre les manuscrits — ou, du moins, ce qu’il en restait.
Le but de Bourdon était de faire un Poète, un Poète prophète par qui passait la voix des Muses, inspirant son destin de martyr, apte à provoquer les vibrations du sentiment, un avatar du poète maudit, merveilleusement doté de qualités exploitables, l’enfance paysanne, la famille illettrée, le prodigieux don des langues, la mort tragique et ainsi de suite, le tout composant un portrait d’« anarchiste de la grâce » qui lui servait de faire-valoir. Robin avait écrit la poésie que Bourdon aurait voulu écrire.
En attendant, ce qui m’intéressait, c’était l’œuvre perdue de Robin, ces textes qu’ayant obtenu des laisser-passer pour entrer à la Bibliothèque nationale au lieu d’aller m’ennuyer au lycée, j’avais découverts et qui disaient tout à fait autre chose. Mais, bien sûr, Bourdon avait rassemblé autour de lui une Société des Amis d’Armand Robin dont il était le président, et, distribuant ici des textes, donnant ici des conférences, il avait verrouillé tout accès aux textes qu’il exploitait. Tout le monde s’en accommodait, hormis quelques chercheurs qui, découragés, abandonnaient le terrain, ce qui était la sagesse. Pour ma part, hélas, comme par la suite lors de l’affaire Luzel, j’ai choisi de résister.
.
2. DONNER À LIRE UN AUTRE AUTEUR
Il m’a semblé possible de résister de deux façons :
— Tout d’abord, publier les textes d’Armand Robin qu’au fil des années j’avais assemblés, parcourant des dizaines de périodiques à la Bibliothèque nationale pour les retrouver : deux volumes d’Écrits oubliés sont parus en 1986 (le premier volume contenant les essais critiques et le second les « non-traductions »).
.
.
.
.
La même année, j’ai publié une longue nouvelle d’Alexei Rémizov traduite par Armand Robin, Savva Groudzine.
.
.
— Ensuite, soutenir une thèse de Doctorat d’État afin de soumettre à un jury objectif l’état des connaissances sur un auteur somme toute interdit. Cette thèse s’intitule : Armand Robin, bilans d’une recherche. N’ayant pas l’intention de me poser en spécialiste mais de donner à lire les textes d’Armand Robin et d’ouvrir des voies de recherches qui me semblaient nouvelles, j’avais fait suivre les trois volumes de thèse de quatre volumes d’annexes donnant des projets d’édition de livres que j’espérais faire paraître après ma soutenance.
Au moment où je terminais la rédaction de cette thèse, Robert Gallimard m’avait appelée pour m’informer qu’Alain Bourdon venait enfin de restituer le fonds Robin. Je me suis alors rendue aux éditions Gallimard avec André Markowicz et nous avons commencé l’archivage de ce fonds, pour lors bien amaigri puisqu’il ne restait plus qu’un millier de pages sur les trois valises remplies par Georges Lambrichs et Claude Roland-Manuel. Or, à l’intérieur des manuscrits restitués se trouvait un ensemble identifiable sous le titre Fragments qui montrait que Robin avait fait éclater la distinction entre prose et poésie, critique et poésie, traduction et poésie, traduction et critique. À comparer papiers et machines (ce que j’ai fait avec l’aide de spécialistes de l’ITEM) on pouvait établir qu’Armand Robin ne l’avait pas écrit dans un dernier sursaut créateur comme le laissait accroire Alain Bourdon, mais vers 1942, avant de se dire dépossédé de soi et d’entrer dans le grand dés-œuvrement de la non-traduction.
.
.
J’ai publié le recueil des Fragments en 1992 aux éditions Gallimard. Il avait été convenu que ce volume remplacerait Le Monde d’une voix, et que Ma Vie sans moi serait republié correctement, avec la partie traduite donnée en miroir. Non seulement cet engagement n’a pas été respecté mais Le Monde d’une voix a été réédité en 2006 par André Velter — réédité tel quel, suivant Ma Vie sans moi tronqué et suivi de la notice biobibliographique de Bourdon toujours criblée d’erreurs. Pas tout à fait tel quel, cependant : l’édition a été agrémentée d’un « poème indésirable » pour bien montrer que Robin était un vrai poète maudit.
Les Fragments dérangeaient : ils ont, peu après, disparu. Reste Le Monde d’une voix, qui donne l’image requise du poète et fait donc désormais référence.
En compagnie d’un jeune historien, Dominique Radufe, auteur d’un très remarquable mémoire sur Armand Robin écouteur, j’avais rassemblé une collection de bulletins d’écoute et avais mis en chantier un projet d’édition de ce travail. Si, pour ma part, je n’ai pas pu l’éditer, Dominique Radufe a publié Expertise de la fausse parole chez le même éditeur, Ubacs, à présent disparu. Il ne s’agissait pas là de rééditions, mais d’édition de textes jusqu’alors inconnus et que nous avions retrouvés et dactylographiés. Quant à la recherche des bulletins d’écoute, elle nous a demandé des centaines de démarches, de courriers et de voyages, jusque dans le sud de la France pour explorer les archives du poète Edmond Humeau qui avait emporté la collection de bulletins d’écoute du Conseil économique et social. Ainsi avons-nous réuni, catalogué, analysé plusieurs centaines de bulletins d’écoute. Ce que nous en avions conclu n’était assurément pas en phase avec la doxa et tous ces travaux sont restés lettre morte.
.
.
J’avais passé longtemps à rechercher les émissions de Poésie sans passeport, extraordinaire expérience radiophonique associant traduction et poèmes en langue originale. Ayant retrouvé douze émissions, je les avais transcrites, transposant graphiquement les textes de dix langues et les traductions avec les entrelacements, les reprises, les alternances… Je n’ai jamais pu obtenir que l’INA s’intéresse à ce travail mais, en 1990, j’ai publié le texte de ces émissions sous le titre Poésie sans passeport. Pour cette édition, il m’a fallu chercher le texte original des poèmes traduits du russe, du hongrois, de l’arabe, de l’italien, du breton et autres langues ; chercher des spécialistes pour vérifier la transposition ; reproduire les entrelacements, alternances, reprises sonores de ces émissions dont le réalisateur lui-même, Claude Roland-Manuel, ne savait pas qu’elles étaient répertoriées. Dominique Radufe avait, quant à lui, retrouvé dans les archives de l’INA les rapports des écouteurs chargés de juger ces émissions — il s’agissait là d’un matériau tout nouveau et qui ouvrait sur des recherches passionnantes…
Ces recherches ont connu un début de réalisation — notamment quand, avec André Markowicz, nous avons ébauché un travail de réflexion sur le mythe de la traduction. Nous avons commencé par rassembler ce que nous pouvions savoir sur les traductions du russe d’Armand Robin, et j’ai publié un numéro de la revue Obsidiane sur Robin traducteur. C’était d’ailleurs une occasion de rendre hommage à Philippe Jaccottet, qui reste bien le seul à avoir pris en compte l’expérience de Robin dans sa singularité.
.
.
J’avais prolongé ce travail par des échanges avec Pierre Leyris que j’aimais beaucoup, et qui, ayant incité Robin à traduire Shakespeare, s’était trouvé au milieu d’un groupe de traducteurs dont il avait pu confronter des expériences. Tout cela se situait en un temps où je me trouvais moi-même traduire selon une méthode qui, sous l’influence d’André Markowicz, élève d’Etkind, avait pris quelque rigueur. Nous avions alors entrepris de traduire Rémizov — l’éditrice avait reçu l’aide du CNL sur un manuscrit que nous avions remis mais une autre traduction, tout à fait désastreuse, devait voir le jour, et Rémizov est un auteur autant dire disparu. Par ailleurs, j’avais en cours la traduction des œuvres poétiques complètes de Sylvia Plath — je le rappelle ici car nous sommes, comme dans le cas de Rémizov, au cœur de notre sujet : j’avais entrepris de traduire Sylvia Plath en 1991 pour montrer comment cette poésie était rébellion contre la poésie académique du Poète lauréat, son mari, et qui devait la conduire au suicide, Ted Hughes. Je continuais de traduire les poèmes de Sylvia Plath et Marc Petit m’avait rédigé une lettre d’engagement pour Gallimard — mais Ted Hughes bloquait les droits. Il avait composé quelques petits volumes après la mort de Sylvia Plath, des volumes faits de bric et broc, comme pour assumer une vengeance posthume, et, à titre d’essai, j’avais traduit l’un d’entre eux au hasard, Arbres d’hiver. C’est à partir de cette traduction que j’avais commencé à mettre en place les textes pour les traduire en respectant les volontés de Sylvia Plath. Je préparais donc une édition des poésies complètes, en demandant de temps à autre si les droits étaient accordés… Soudain, j’ai appris que Ted Hughes était mort et que les droits étaient libres. Mais c’était André Velter qui s’occupait de la poésie et une de ses amies, la poétesse Valérie Rouzeau, lui avait remis un autre volume traduit : il s’agissait de faire en urgence un recueil avec tout ça. J’étais alors occupée par l’Affaire Luzel et j’ai commis l’erreur de laisser faire… Arbres d’hiver est le seul de mes livres dont j’ai honte. Quant aux Œuvres de Sylvia Plath, je n’y suis qu’en contrebande : mes traductions ont été exploitées sans aucune autorisation. J’ai refusé de signer le contrat qui m’était envoyé, ce qui n’a pas empêché mes traductions de paraître, pêle-mêle avec d’autres (Valérie Rouzeau avait d’ailleurs déjà publié mes traductions avec les siennes sans la moindre autorisation dans un volume par elle publié chez Jean-Michel Place). Le mythe de la traduction, qui repose sur la croyance en une instance inspirante, mythe théologique appuyé sur le mépris du texte et menant par conséquent à des traductions consternantes, n’empêche nullement de mélanger des traductions relevant de principes totalement opposés : l’incohérence ne pose aucun problème puisque seule parle la Voix qui fait entendre sa voix. Ted Hughes correspond assez bien au Poète bourdonnien et je ne rappelle cette expérience que pour mettre en perspective l’inutilité de l’édition des textes de Robin — et, par voie de conséquence, l’étonnant courage qu’il lui avait fallu pour se risquer dans une entreprise vouée, elle aussi, à une incompréhension totale.
Si, de ces traductions de Sylvia Plath, il n’est resté que quelques textes mis au service d’une entreprise qui était exactement ce à quoi j’entendais m’opposer en traduisant et si, de cette entreprise pour faire lire Robin sous un jour nouveau, il n’est resté que ce qui venait conforter les lieux communs que j’avais voulu combattre, je n’y vois que la conséquence d’un dispositif fait pour normaliser ce qui aurait pu échapper au commerce littéraire. Les Fragments donnaient à voir la perdition : il fallait les remplacer par Le Monde d’une voix. Chose faite. Et le Poète pouvait, comme l’écrivait d’ailleurs Bourdon en conclusion de sa préface au Monde d’une voix, inviter le lecteur à aller « chercher rassurance en poésie ».
J’avais cherché à faire connaître un autre auteur : il n’avait pas lieu d’être, ce qu’il avait d’ailleurs constaté lui-même. Il fallait qu’il disparaisse. Je n’avais pas à me plaindre : pour moi, la poésie commence où le Poète disparaît. Il me restait à voir s’accomplir le resurgissement du Poète et la disparition de mon travail.
.
.
.
II. FALSIFICATIONS
.
Il va de soi que le petit monde littéraire rassemblé par Bourdon autour du Poète qu’il avait su rendre tout à fait convenable ne pouvait que s’outrager des mes publications : chaque parution des textes de Robin était, en même temps qu’une révélation, un pavé dans la mare. Ces publications ont suscité nombre d’articles, et parfois tout de même des articles très élogieux — et ceux-là même qui entendaient préserver la vision bourdonnienne ne pouvaient totalement blâmer l’édition de textes jusqu’alors inconnus —, mais tout ce que montrait cette floraison d’articles, c’est à quel point une vision nouvelle, en un domaine où le consensus fait loi, est apte à faire lever les clichés et révéler les articles du dogme.
Pour ma thèse (qui, à l’origine, visait à étudier la fabrique du Poète), j’avais rassemblé tous les articles produits sur Robin — au total, 666 articles : il me restait à voir comment évoluait le Poète fabriqué par Bourdon alors même que les faits par lui énoncés se révélaient faux. La réponse est bien simple : le Poète n’évoluait pas. Il était possible d’ajouter des faits contradictoires, de les établir, de fournir même des chronologies : l’institution littéraire les broyait pour les ramener au connu.
.
- LE POÈTE EN PIED
Je ne voudrais pas omettre de signaler la parution, en 1981, du volume de la collection Poètes d’Aujourd’hui, apothéose de l’œuvre bourdonnienne et, finalement, vérité ultime sur le Poète. Il n’est pas inutile de s’attarder à en reprendre l’essentiel puisqu’il y a là l’énoncé de la doxa : « L’un des traits du génie d’Armand Robin est d’avoir compris, adolescent, qu’un poète est, par destination, l’un de ceux qui ont pour mission de se porter aux remparts de notre monde stagnant et de chasser de derrière les murailles ceux qui veillent sournoisement et tiennent en captivité la pensée anesthésiée par des langages fallacieux. Armand Robin a pris naissance dans un monde menacé d’étouffement. Au commencement était le Silence ». Tel est donc le début. Le Poète prophète, « venu d’un peuple muet » se livre à un sacrifice christique en ne livrant à l’édition « que des bribes de sa production personnelle » mais « comme si s’était réveillé dans l’âme de ce traducteur-né, un cosmo-mimétisme, un besoin d’harmonie, un instinct antérieur à l’histoire mais enfoui sous les ruines qu’ont accumulées les bâtisseurs successifs de Babels dérisoires », il se lance dans la traduction des plus grands poètes car « ils nous convient à communier dans l’Être avec eux ». Bref, c’est la conclusion, « l’œuvre d’Armand Robin traduit le pari que font les hommes sur l’existence et proclame leur volonté d’accomplissement par l’Esprit, par la parole, par la Résurrection du Verbe. »
Le vocabulaire liturgique n’est pas là par hasard : le Poète, c’est le christ ; il traduit inspiré par l’Esprit saint et son verbe est rédempteur. Ce verbiage est ce sur quoi tourne sans fin l’institution poétique (et qui fait d’ailleurs que les lecteurs se détournent de la poésie comme de la messe).
Alain Bourdon allait trouver un suiveur en la personne d’un professeur de collège du nom de Jean Bescond qui, après avoir publié une brochure aux éditions Skol Vreizh devait, à partir de cette brochure, créer un site Internet, le site armandrobin.org.
Je précise — ce n’est pas sans importance pour la suite — que la brochure intitulée Armand Robin, la Quête de l’universel est parue en mai 1989 et que ma thèse avait été soutenue en janvier 1989.
Pour illustrer la méthode Bescond un petit tableau suffira.
J’avais rédigé des notices chronologiques résumant l’itinéraire d’Armand Robin pour le premier volume des Écrits oubliés parus en 1986. Je les avais rédigées de manière aussi exacte et concise que possible en vue d’éclairer un itinéraire très erratique. En effet, loin d’être le militant anarchiste pur et dur sur lequel épiloguaient sans fin les critiques à la suite d’Alain Bourdon, Armand Robin n’avait adhéré à la Fédération anarchiste qu’après guerre et, loin d’avoir été assassiné dans un commissariat pour avoir proclamé « je suis un fellagha », il soutenait l’OAS…
Dominique Radufe et moi avions analysé, en nous basant sur les bulletins d’écoute notamment, les prises de position politiques d’Armand Robin : au lieu de dissimuler ces errements, il nous semblait intéressant de les étudier, et surtout de montrer à quel point l’approche biographique était inappropriée dans le cas d’un auteur qui s’était voulu sans vie. Ce pauvre Robin n’avait cessé de le clamer sur tous les tons : il récusait toute biographie. Hélas, le on-dit, le ragot, la « somme de sottises, trouvailles, mesquineries, erreurs, platitudes, vérités » qu’il n’avait cessé de dénoncer dès sa fausse dissertation d’agrégation sur Madame de Sévigné étaient déversés là, le « forfait biographique » menant de ses cahiers de notes à ses relations conjugales, ses amours pathétiques avec Monique Dupont, le petit moineau, et ainsi de suite.
Mes recherches étaient donc exploitées mais travesties, tous les faits gênants passant à la trappe. Bourdon avait peut-être l’excuse de l’ignorance, Bescond ne l’avait pas. Il s’agissait d’une construction en trompe-l’œil, fabriquée pour venir appuyer le lieu commun mis en place par Le Monde d’une voix. On conçoit que le « monde comme si » des nationalistes bretons ait trouvé dans le « monde comme si » du poétisme bourdonnien son prolongement.
Lorsque mon directeur de thèse m’a assigné à comparaître pour, somme toute, avoir osé dire la vérité, comme, en fin de compte, le tribunal l’a établi, j’ai vu apparaître des attestations de Bourdon, Bescond et je cite dans Le Monde comme si l’attestation d’un de ses associés, un nommé Joubin m’accusant d’avoir « sévi sur Armand Robin » et « fait des ravages dans le pré de la littérature bretonne » en dissimulant mes griffes de « féroce félin prêt à tout devant la proie qui refuse de se rendre ».
Par la suite, j’ai publié un recueil de poèmes et de photographies d’Armand Robin, sous le titre Le cycle du pays natal ; j’ai aussi participé à un film (La vraie légende d’Armand Robin), à des émissions, à des colloques ; j’ai rédigé des articles, j’ai donné un « dossier Robin » au site remue.net...
Rien de tout cela n’a servi.
Même la projection du film La vraie légende d’Armand Robin, qui avait tout de même le mérite de se terminer par un passage ouvrant sur les Fragments, n’aboutissait qu’à relancer le mythe. Projeté le 3 novembre 2010, à l’initiative de l’INA, de la Maison des écrivains, du Magazine littéraire avec l’aide du Centre national du Livre et de la Mairie de Paris, le film provoque l’invitation de Valérie Rouzeau chargée de le commenter, ce qui donne, sous le titre, « Saurons-nous un jour, saurons-nous jamais qui fut Armand Robin, ce miracle, cette catastrophe ? », ce texte synthétique :
« Un enfant inadapté ; burlesque ; la passion de la justice contre toute “fausse parole” ; anarchiste ; traître de mélodrame avec des mains d’étrangleur ; un ange ; un sanglier ; quelque chose en lui de colossalement meurtrier ; un enfant qui sait s’amuser ; mépris de l’argent ; il ne dormait pas il s’écroulait ; son caractère le portait à l’isolement ; pour l’aimer il fallait faire certains efforts ; l’idiot du village ; un gosse ; un regard bleu qui ressemblait au regard noir de Léautaud (…) le rimmel du coeur ; vivait dans un rêve ; un homme tourmenté ; des fiancées platoniques ; dru ; enraciné ; fidèle ; singulier ; armé pour la lutte ; volubile ; maladroit ; timide ; perpétuellement malheureux ; très atteint ; capricieux ; de la plus grande délicatesse… »
Un florilège..
Pensant pour en finir publier un essai sur cette étrange expérience, j’avais commencé à rassembler tous mes documents et, en 2004, j’avais déposé à l’IMEC un fonds Robin.
Il s’agissait pour moi de donner à comprendre par les correspondances, les livres que j’avais achetés, la terrible solitude d’un jeune écrivain égaré dans le milieu littéraire, puis l’étrange perdition consentie et cette expérience littéraire unique, si mal comprise, rendue incompréhensible par la prolifération de discours critiques brassant et rebrassant les mêmes inepties.
.
2. MÉTHODOLOGIE DU PLAGIAT
En 2004, je dépose un fonds Robin à l’IMEC.
En 2004, une universitaire, Anne-Marie Lilti, maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise, entreprend d’écrire une biographie d’Armand Robin. Passons sur ce que Robin appelait le « forfait biographique ». Robin n’avait pourtant cessé de le répéter : « Toute biographie est destructrice, subversive ; elle refait à rebours la route conquise pas à pas par chaque homme en sa vie ; il faut laisser à la police ce genre littéraire ». Mais, rien à faire : biographie.
En 2008, la biographie, intitulée Armand Robin, le poète indésirable, paraît aux éditions Aden : Anne-Marie Lilti est présentée comme « spécialiste d’Armand Robin » quoique sa bibliographie ne mentionne en tout et pour tout qu’un unique article paru dans une obscure revue de l’université de Cergy-Pontoise.
À la fin de sa biographie, la spécialiste donne pour seule source fiable la brochure de Jean Bescond — qui a rédigé la préface de sa biographie. Elle insiste : « Une excellente chronologie — la seule fiable à l’heure actuelle — très sérieusement documentée, a été réalisée par Jean BESCOND et se trouve dans son ouvrage Armand Robin, la Quête de l’universel, édité chez Skol Vreizh » (p. 345). Bis repetita placent, elle y revient trois pages plus loin : « Cet ouvrage (la brochure Armand Robin, la Quête de l’universel) contient la seule chronologie fiable et sérieusement documentée sur Armand Robin ».
Cependant, il suffit de comparer la biographie et le texte de la brochure de Jean Bescond pour le constater, ce n’est absolument pas de cette chronologie si fiable qu’elle s’inspire, mais de la chronologie que j’avais placée au début de ma thèse (je l’ai, depuis, mise en ligne sur le site remue.net). Elle pille également les notices chronologiques que j’avais rédigées pour les Écrits oubliés, et les éditions de La Fausse parole et des Fragments.
Et néanmoins, en préface, Jean Bescond l’assure, « pour mener à bien cette biographie, il aura fallu rassembler les travaux menés depuis 40 ans car à la mort du poète on ne disposait que de lambeaux informes. Il aura fallu faire le tri, analyser les œuvres y compris les traductions et les articles critiques, compulser les archives des fonds constitués et dispersés, mener des recherches nouvelles car il existe toujours des pans entiers non explorés chez Robin. »
En bref, depuis quarante ans, c’est-à-dire depuis la parution du Monde d’une voix suivi de la notice biobibliographique d’Alain Bourdon, rien à signaler : tout restait à faire.
Si je me suis décidée à porter plainte pour contrefaçon, ce n’était pas du tout pour défendre mon travail, qui était librement disponible dans toutes les bibliothèques, et que j’avais d’ailleurs toujours donné bénévolement, mais parce qu’il s’agissait d’une universitaire qui, en tant que telle avait un devoir d’exemple à l’égard des étudiants. Et aussi — mais il va de soi que cela ne concernait en rien les magistrats — parce que cette universitaire pillait mes recherches pour, d’une part, les mettre au service des lieux communs que j’avais combattus, et, d’autre part, les rendre stupides. C’est, en vérité, surtout l’insondable sottise des propos détournés qui m’a indignée, et c’est cette indignation qui m’a résolue à porter plainte pour plagiat. J’avais fait preuve de patience pendant des années, mais la mesure était comble.
Ma plagiaire a été condamnée. Le jugement est lisible en ligne et je ne vais pas m’attarder à reprendre ici la liste des emprunts jugés par mon avocate suffisamment probants pour éviter à un magistrat de perdre son temps : cette liste est également disponible.
Ce qui rend ce cas intéressant est, en fait, la raison du plagiat, à savoir l’asservissement au lieu commun. La plagiaire avait soutenu en 1999 une thèse de doctorat d’université intitulée Langue étrangère et langue poétique. Cette thèse comporte un chapitre consacré à Robin ; sur les 38 pages de ce chapitre, on trouve 36 références à mes recherches, toutes correctement sourcées ; la brochure par la suite jugée si fiable de Bescond n’apparaît pas même dans la bibliographie de cette thèse.
Je me bornerai à un seul exemple — un exemple qui a été soumis aux magistrats et qui a fait l’objet d’un jugement. Il me semble montrer le glissement de la référence à la contrefaçon.
Comme je l’ai dit, Bourdon a réédité le premier (et, à dire vrai, le seul) recueil de poèmes de Robin, Ma vie sans moi, en supprimant toute la partie traduite (que j’ai publiée, faute de mieux, dans le second volume d’Écrits oubliés). Un texte de transition semble particulièrement important puisqu’il forme une sorte de charnière entre la partie traduite et la partie non traduite. Il s’agit d’une chanson sur Essénine donnée comme écrite par un paysan russe de la région de Riazan.
Dans les Écrits oubliés , je consacrais une assez longue note à cette « non-traduction » : « La Vie d’Essénine » attribuée à un « paysan russe de la région de Riazan » est à la fois un faux poème d’Essénine, un vrai poème de Robin… » Et j’ajoutais : « Le poème « Vie d’Essénine chantée par un paysan russe de la région de Riazan » ne figure dans aucun des recueils d’Essénine […] et une lettre à Jean Paulhan indique clairement : « Je suis seul responsable de cette vie d’Essénine que j’attribue à un paysan russe » (16 novembre 1938). » (Écrits oubliés, p. 262).
Cette citation est reprise dans la thèse d’A.-M. Lilit, correctement référencée et suivie du commentaire : « Françoise Morvan met en évidence le fait que ce texte, présenté comme traduction, a été vraisemblablement écrit par Armand Robin lui-même, produisant un effacement des limites entre poésie personnelle et poésie traduite. » Mais dans la biographie, A.-M. Lilti s’attribue la découverte : « Cette “Vie d’Essénine” qui figurera dans Ma vie sans moi a fait couler beaucoup d’encre : fausse traduction, vrai poème de Robin, nous avons ici la preuve, de l’aveu même d’Armand Robin que ce poème « traduit » dont nul n’a jamais retrouvé l’original — et pour cause ! — est un faux. » La seule encre qui ait jamais coulé à ce sujet est la mienne mais la plagiaire assurera jusqu’au bout avoir fait là une trouvaille toute personnelle.
Cet exemple est intéressant pour une raison autre que judiciaire : il montre à quel point, même dans sa thèse, lorsqu’elle cite correctement, l’universitaire ramène mes recherches à la vision bourdonnienne. Le commentaire est ici stupide puisque Robin, comme je le signale, assume au grand jour, non pas l’effacement des limites entre poésie personnelle et poésie traduite, mais le détournement de la traduction ainsi mise en miroir.
Il faut coûte que coûte admettre que si Robin traduit, c’est qu’il doute de ses dons de poète : poète mais traducteur, et traducteur faute de mieux, ça va de soi. Les catégories sont celles de la mythologie romantique maintenue au mépris même du texte. Pour en arriver à rabattre mes constatations sur le lieu commun attendu, A-M. Lilti n’hésite pas à tronquer les citations, avant de les engluer dans un discours normatif comme destiné à le normaliser. Je me bornerai, là encore, à un seul exemple. L’idée n’est pas bien compliquée : je constate que la poésie même de Robin est déjà mimétique, et que la traduction y affleure. Voici ces quelques phrases :
« Il n’est guère de poème, à dire vrai, qu’épargne l’influence de Valéry — or, l’imitation a ceci de particulier qu’elle résulte de la fusion de textes parfaitement localisables dans l’œuvre de Valéry mais dissous, détruits, mis en relation avec d’autres textes comme par un travail de traduction, identifiables et méconnaissables — ce qui sera le cas de toutes les traductions de Robin — et que l’on peut parfaitement percevoir ensemble la voix de Robin, celle de Valéry, et les réminiscences tout à fait évidentes de Rimbaud, Apollinaire ou Mallarmé. »
Ce texte devient :
« Dans sa thèse de doctorat, Françoise Morvan montre que les poèmes de Robin, notamment ceux de Ma Vie sans moi, sont marqués par l’influence de Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, au point d’apparaître parfois comme un véritable patchwork de textes étrangers “parfaitement localisables” mais comme “dissous, détruits”, à la fois “identifiables et méconnaissables” (MORVAN : 107). »
Et suivi de ces commentaires : « Robin ne parvient pas, et il le sait, à être un “poète véritable”, c’est-à-dire, selon sa propre définition, un “créateur” et non un “fabricant de poèmes”. La traduction va alors être un véritable palliatif du manque, permettant de créer, d’écrire de la poésie… D’où le terme de non-traduction. »
Le contresens est total. Je trouvais captivant de voir dans les premiers poèmes le creuset d’une expérience littéraire qui allait faire de la traduction le lieu de passage de la poésie au lieu d’un substitut ou d’un pis-aller : l’universitaire supprime le cœur de la citation et explique que ce pauvre Robin a trouvé un substitut, un pis-aller : la traduction.
Le contresens est, de plus, basé sur de fausses citations car jamais Robin n’a opposé le « poète véritable » au « fabricant de poèmes », terme qu’il n’a jamais employé, bien qu’il figure ici entre guillemets.
J’ai choisi cet exemple car il montre, me semble-t-il, sur quelle base s’effectue le glissement vers le plagiat. Dans un premier temps, l’universitaire récupère, rebricole, écrase tout en respectant l’origine du matériau ; dans un deuxième temps, elle assimile le matériau, se l’approprie et fait tout simplement glisser le travail d’autrui sous son nom. Ce qui lui semble éminemment louable dans la mesure où il s’agit de servir la norme, contre la dissidence, et de restituer un Poète là où il y avait un manque.
Je me suis indignée de voir comment certains passages de ma thèse, concernant notamment l’itinéraire politique de Robin, étaient travestis, le but d’Anne-Marie Lilti étant de faire de Robin un Poète anarchiste de la première à la dernière heure. Ce n’était là qu’une composante d’un ensemble destiné à faire du Poète ce qu’il devait être.
J’en donnerai quand même un exemple pour illustrer peut-être plus clairement la méthode du plagiat. Dans la chronologie de ma thèse, j’écris (p. 28) :
« 1941. Robin envisage de seconder Drieu la Rochelle[1] , de travailler pour la collection de la Pléiade (les auteurs qu’il retient sont Jean-Jacques Rousseau, Nerval, Vigny, Renan — il collabore effectivement au volume de Théâtre de Goethe pour trois pièces en un acte, Mahomet, Satyros ou le faune fait dieu, Les dieux, les héros et Wieland, — et de participer au Tableau de la littérature (pour les auteurs suivants : Hugo, auquel il a consacré un diplôme d’études supérieures, Chateaubriand, Vigny). »
Version Lilti (biographie, p. 123) :
« Début 1941, il envisage de collaborer aux volumes de la Pléiade, que dirige Paulhan, sur Rousseau, Nerval, Vigny, Renan, mais ces projets n’auront pas de suite. En revanche, il participe au volume consacré au théâtre de Goethe et au Tableau de la littérature pour Hugo, Chateaubriand et Vigny. »
Une petite coupe : exit le projet de seconder Drieu La Rochelle. Il n’en sera plus jamais question dans la biographie. Une erreur est ajoutée au passage : j’ai bien écrit que Robin envisageait de participer au Tableau de la littérature, non qu’il y avait participé, chose qu’il n’a pas faite.
Encore une fois, l’essentiel pour la plagiaire n’est pas d’exploiter mes recherches mais de les faire servir à une entreprise de normalisation. Ce qu’elle propose, c’est ce qui aurait dû toujours être proposé, une biographie de Poète, celle que les institutions confient à une poétesse la charge de résumer, celle que le Centre national du Livre cautionne.
Car cette biographie est parue avec l’aide du Centre national du livre.
Le fait qu’aucun emprunt ne soit référencé n’a gêné personne ; le fait qu’une thèse d’État ait été soutenue sur le sujet n’a incité aucun des juges et censeurs à la moindre vérification ; le fait que des passages entiers des Écrits oubliés, faciles à trouver en bibliothèque, aient été repris n’a éveillé l’attention de personne. Les redites, les incohérences, les étonnantes de fautes de grammaire et la ponctuation erratique n’ont en rien dérangé les responsables de la distribution d’aides à l’édition — quand, par ailleurs, tant de projets sont refusés. Il y avait là un produit convenable, jugé adéquat, en tout cas répondant à l’attente des lecteurs et digne de la renommée des Lettres françaises, une biographie de poète correspondant à ce que des intellectuels français chargés de juger de la qualité des ouvrages méritant d’être subventionnés sur fonds publics considèrent comme louable.
3. LA FABRIQUE DE L’ŒUVRE
La biographie d’Anne-Marie Lilti n’était elle-même qu’une petite part d’un ensemble qui lui donnait sens et, tout à la fois, l’expliquait.
En effet, si l’on se penche sur les publications de textes de Robin, on constate qu’en 2006, paraît à librairie La Nerthe un recueil de lettres d’Armand Robin à Jean Guéhenno et Jules Supervielle publié et préfacé par Jean Bescond.
En 2008, paraît aux éditions Aden la biographie d’Anne-Marie Lilti Armand Robin, le Poète indésirable, avec préface de Jean Bescond.
En 2009, paraît aux éditions Jean-Paul Rocher, avec préface d’Anne-Marie Lilti, un volume de textes d’Armand Robin rassemblés par Jean Bescond, Le Combat libertaire.
Le but de ces trois livres est le même : fabriquer une biographie de poète anarchiste conforme à la mythobiographie fabriquée par Alain Bourdon.
.
- La correspondance Robin-Guéhenno
Avant de soutenir ma thèse, j’avais à plusieurs reprises rencontré Annie Guéhenno, qui m’avait permis de consulter les manuscrits de son mari, notamment le Journal des années noires où Guéhenno évoque Robin, sous son nom dans le manuscrit, sous initiales dans le livre.
Je m’étais rendue avec elle à une réunion au cours de laquelle avait été évoquée la possibilité d’une publication des lettres de Robin à Paulhan et, exposant à quel point publier cette correspondance aurait été désastreux dans le cas d’un auteur dont les textes étaient si peu connus et qui avait exigé le droit à l’inexistence, nous avions, Annie Guéhenno et moi, obtenu gain de cause. Annie Guéhenno s’était engagée à ne pas publier la correspondance de Robin avec son mari. Claire Paulhan en avait été furieuse et s’était vengée en donnant au Monde un article perfide sur les Fragments.
Annie Guéhenno est décédée en mai 2006 ; dès l’automne 2006, Jean Bescond a fait paraître ces lettres, avec une préface où il travestit des faits établis depuis plus de vingt ans, allant jusqu’à feindre d’ignorer qu’« X le poète » est bien Robin, ce jeune collabo que Guéhenno flanque à la porte le 27 juillet 1940 :
« X.. le poète vient me voir. Je l’interroge sur son expérience de soldat. Il me parle de l’armée comme du plus invraisemblable monstre surréaliste. Ce qui n’est pas mal. Quant à l’événement, l’histoire ne l’intéresse pas. Alors il va continuer ses petites recherches, “travailler à ses poèmes”. Au total, il est assuré que sa liberté n’est pas menacée. Il vivra retiré au fond de son fromage poétique. Je l’ai mis à la porte. Ces jouisseurs me dégoûtent. Il eût été ridicule de discuter, d’expliquer que la poésie, la grande, la vraie, est connaissance et, par conséquent, liberté, la liberté même… »
Guéhenno, qui refuse d’écrire sous l’Occupation, est indigné par l’attitude de Robin qui collabore à la NRF de Drieu — et, aggravant son cas, y publie en janvier 1941 un article où il blâme ceux qui ont fait le choix de se taire : « Par bonheur, ni Voltaire ni Diderot ne raisonnaient ainsi : leur pensée ne leur paraissait point de l’or en barres ou des billets en cave et ils ne se jugeaient pas fondés à la retirer de la circulation pour punir une méchante société ». Cet article provoque à nouveau l’indignation de Jean Guéhenno :
« 24 janvier. Drieu réunit ses derniers articles et me les envoie avec cette dédicace : “ À J. G. qui me donnera un jour un article sur Voltaire. ” Nous n’avons aucun moyen de dire à ces messieurs ce que nous pensons de leur activité. Du moins pourraient-ils nous laisser en paix. Le comble est qu’ils essaient de faire passer notre silence et le parti que nous avons pris de ne rien publier pour une lâcheté. “Par bonheur, écrit l’un d’eux dans le dernier numéro de la NRF, ni Voltaire ni Diderot ne raisonnaient ainsi.” Ces hommes qui tendent les mains aux chaînes se donnent pour des Voltaire… Rien d’autre à faire que de grincer des dents. Impossible de répondre sans s’offrir à entrer dans les prisons de l’occupant. »
Si la correspondance s’interrompt, c’est pour une raison parfaitement claire et connue de longue date puisque je l’ai établie depuis des lustres : Guéhenno a flanqué Robin à la porte. Jean Bescond feint de s’interroger : « Inexplicablement à première vue, leur correspondance s’arrête en 1940 » (p. 15). « Inexplicablement » fait passer à la trappe les pages du Journal des années noires, et « à première vue » laisse à supposer que la correspondance a pu se poursuivre. « Les temps troublés sont favorables aux disparitions du courrier », écrit-il. Le facteur a bon dos…
.
- Le combat libertaire
Mais Jean Bescond (avec la caution d’Anne-Marie Lilti) va plus loin encore.
Dans les deux volumes des Écrits oubliés, publiés en 1986, j’avais rassemblé les textes d’Armand Robin jusqu’alors épars en des centaines de journaux — textes qu’il avait fallu retrouver, photographier à l’annexe de la Bibliothèque nationale à Versailles, où la photocopie était interdite, puis dactylographier, avant d’en donner une édition. J’avais rédigé des notices chronologiques factuelles pour les situer à leur place dans l’ensemble d’un travail qui devait se dérouler, avec toutes ses incohérences et ses ambiguïtés, sous les yeux du lecteur.
Le calcul n’est pas compliqué : les textes du Combat libertaire viennent des Écrits oubliés, à l’exception des Poèmes indésirables, des Poèmes d’Ady (pourtant par la suite vendus par Robin aux éditions du Seuil, puis aux éditions Le temps qu’il fait…), plus cinq textes, dont un d’attribution douteuse, et deux traductions déjà publiées ailleurs. Alors que la publication se donne pour exhaustive, font défaut plusieurs textes sur l’anarchisme. Pas une seule mention des Écrits oubliés dans ce volume, ni dans l’introduction d’Anne-Marie Lilti, ni dans les textes divers de Jean Bescond.
Leur démonstration n’est pas compliquée non plus : Armand Robin était, dès 1937, anarchiste, il l’était encore sous l’Occupation, avant d’adhérer à la Fédération anarchiste en 1945, et il devait le rester jusqu’à la fin de ses jours.
Pour mener à bien cette démonstration, la méthode est toujours la même : ce qui dérange passe à la trappe.
A. Un texte tronqué
D’après Jean Bescond, la première expression officielle du combat libertaire d’Armand Robin, c’est la publication dans la revue Esprit, en 1937, du texte « Une journée ».
J’avais publié ce texte dans les Écrits oubliés, mais une longue note avait été coupée par l’imprimeur à la composition. Je l’avais reproduite in extenso dans ma thèse et, de nouveau, en annexe.
Cette note commence ainsi :
« Nous ne nous attardons pas ici aux querelles byzantines entre staliniens, trotskistes, anarchistes, fascistes et autres réactionnaires actuels ou virtuels, aux querelles qui ne peuvent intéresser que des bourgeois ou des intellectuels. »
« Anarchistes, fascistes et autres réactionnaires », telle est la pensée politique d’Armand Robin en 1937.
Cette note figure en deux endroits de ma thèse que ma plagiaire a lue et relue. Elle a donc, en toute connaissance de cause, cautionné la publication d’un texte tronqué.
.
B. Un contexte falsifié
D’après Jean Bescond, le combat libertaire de Robin a culminé avec, le 5 octobre 1943, l’envoi à la Gestapo de la « Lettre indésirable n° 1 » commençant par l’adresse « preuves un peu trop lourdes de la dégénérescence humaine ».
J’avais publié cette « Lettre indésirable » en la situant dans une chronologie qui montrait clairement qu’il s’agissait d’un texte sans doute rédigé au moment du grand revirement d’un auteur qui avait compté au nombre des collaborateurs de la NRF et de Comœdia (puisque cette lettre figure dans les Écrits oubliés juste après l’article « Romantisme, symbolisme et surréalisme » donné à cette revue en septembre 1943), mais sans doute plutôt rédigé après-guerre comme les autres « Lettres indésirables ».
Jean Bescond passe de 1937 à 1943, c’est-à-dire du texte antianarchiste « Une journée » à cette « Lettre indésirable » prétendument anarchiste, en effaçant toutes les activités collaborationnistes d’Armand Robin. Ayant ainsi faussé le contexte, il peut assurer que la « Lettre indésirable n° 1 » à la Gestapo a bien été envoyée et Armand Robin arrêté, puis relâché — comme s’il était vraisemblable que le SD, ayant reçu une lettre ouverte dénonçant les camps de concentration, ait pu laisser son auteur repartir tranquillement informer la Résistance de ce qu’il apprenait grâce à ses écoutes pour le ministère de l’Information.
Anne-Marie Lilti écrit, quant à elle, dans sa biographie (p. 179) : « La lettre parvint-elle a son destinataire (sic) ? Fut-elle seulement envoyée ? En tout cas, Robin ne semble pas avoir été inquiété à la suite de cette provocation. » En préface du Combat libertaire, ses doutes ont totalement disparu.
Le fait même d’envoyer en 1943 à la Gestapo une lettre traitant les SS de « tueurs ridicules » suffirait à prouver qu’Armand Robin était étranger à la Résistance. Mais il s’agit de montrer coûte que coûte qu’il était anarchiste, et résistant parce qu’anarchiste. Jean Bescond ne manque d’ailleurs aucune occasion de lire ou faire lire cette lettre en public.
Or, en 1943, comme le montre la correspondance avec Paulhan que Jean Bescond et Anne-Marie Lilti exploitent abondamment lorsqu’elle les sert, Armand Robin ne se disait pas anarchiste mais communiste stalinien, plus communiste qu’Aragon ou Éluard. Il envoyait des lettres portant la mention « Vive Staline ! », ce qui lui a valu, en fin de compte, d’être inscrit sur la liste noire du Comité national des écrivains, alors même qu’il n’avait écrit que des textes littéraires.
Ces faits sont connus de longue date. Ils sont clairement lisibles dans les lettres d’Armand Robin à Jean Paulhan que Jean Bescond a pu étudier à loisir, comme Anne-Marie Lilti. Ni l’un ni l’autre ne peuvent les ignorer. Ils les falsifient en toute connaissance de cause.
3. Des faits occultés
Dès 1986, publiant les textes de Robin que j’avais pu retrouver dans la presse libertaire, j’expliquais, ce qui est un simple constat, qu’il avait adhéré en 1945 à la Fédération anarchiste et avait cessé de publier dans Le Libertaire à partir de 1958.
Dès 1986, et les Écrits oubliés, les références des textes parus dans La Nation française, organe monarchiste, étaient données avant que cette collaboration à la presse d’extrême droite ne soit analysée dans ma thèse, puis dans la réédition de La fausse Parole en 2002 (où il était précisé qu’à partir de 1956, les analyses du bulletin d’écoutes — « l’anticommunisme et la recherche d’une troisième voie contre l’URSS et les USA aidant » —confortaient celles des abonnés de La Nation française).
Toute mention de cette orientation politique, en totale contradiction avec le « combat libertaire » supposé mené par Robin jusqu’à son dernier souffle, a donc été intentionnellement effacée, tant du Combat libertaire que de la biographie d’Anne-Marie Lilti. Cette dernière écrit :
« C’est durant les années 1956-1957 qu’on le voit jouer la provocation en déambulant aux cris de “Je suis un fellagha ! Je suis un fellagha !” ce qui, en pleine guerre d’Algérie, n’arrange pas sa réputation déjà un peu sulfureuse. Mais il est là, à sa façon, en plein accord avec ses camarades de l’ex-Fédération communiste libertaire. »
Rappelant que les prises de position d’Armand Robin étaient, somme toute, celles de La nation française à laquelle il collaborait, j’écrivais en 1988 : « Il est évidemment difficile de concilier ces prises de position avec l’image d’un Robin criant “Je suis un fellagha” au nez des forces de l’ordre, comme le rappelle Alain Bourdon dans tant de conférences et d’articles… » (thèse, p. 556). Alain Bourdon, de fait, promenait de conférence en conférence son poète libertaire, provoquant abondance d’articles qui, à leur tour, venaient consolider la mythobiographie. Il pouvait, du moins, se donner l’alibi de l’ignorance : il n’avait jamais tenté d’analyser les bulletins d’écoute qu’il gardait sous clé, ne se doutant pas que je parviendrais à en reconstituer une collection.
En conclusion, Anne-Marie Lilti et Jean Bescond se sont livrés à une entreprise concertée : la biographie d’Anne-Marie Lilti, précédée d’une préface de Jean Bescond assurant que depuis quarante ans nulle recherche n’était digne d’être mentionnée, se présente comme « ouvrage de référence » donnant la chronologie de Jean Bescond pour « seule fiable » ; le recueil Le combat libertaire, précédé d’une préface d’Anne-Marie Lilti, vient apporter, textes à l’appui, la preuve que la biographie restitue fidèlement un parcours de poète libertaire, par une « spécialiste » autorisée apportant la caution universitaire.
J’ai donc passé des années à rassembler les textes des Écrits oubliés pour voir ces volumes démantelés aboutir au Combat libertaire et pour voir les faits minutieusement établis aboutir à la mythobiographie du Poète indésirable telle que je l’avais combattue.
La biographie d’Anne-Marie Lilti n’est pas seulement un texte massivement plagié, comme le tribunal l’a établi. Elle fait partie d’un ensemble et relève d’une entreprise poursuivie avec constance depuis de longues années.
.
.
.
III. OFFICIALISATION DU MYTHE
.
Il n’est pas difficile de montrer qu’au terme de cette entreprise, plus rien ne demeure de ce que je m’étais efforcée de mettre au jour : le discours officiel est devenu le discours bourdonnien triomphant, comme le montre d’ailleurs le texte rédigé pour la célébration du centenaire de la naissance de Robin (ou du cinquantenaire de sa mort) puisque Robin a fait partie en 2011 ou 2012 des « célébrés nationaux »). J’ignore qui a rédigé ce texte pour le ministère ; lorsqu’il m’a été proposé de participer à une commémoration sur les lieux mêmes de ma naissance et de ma rencontre avec Armand Robin, j’ai refusé, heureuse décision car cette commémoration a donné lieu à un film qu’il est impossible de regarder sans honte.
1. ROBIN CÉLÉBRÉ NATIONAL
Voici, dans le Recueil des célébrations nationales, sur le site interministériel des Archives de France, la version officielle de l’itinéraire d’Armand Robin.
« Huitième enfant d’une famille de cultivateurs, il doit à son acharnement le privilège d’échapper aux servitudes du terroir et de poursuivre des études. Exceptionnellement doué, il est admissible à l’agrégation de lettres. Puis il se lance dans l’aventure sans fin de la connaissance : après le grec, le latin, l’anglais, l’allemand, il apprend le russe, l’espagnol, l’italien. Son bagage lui permet très vite de gagner sa vie : rédaction des Bulletins d’écoutes qu’il rédige à partir de l’écoute des émissions radiophoniques internationales, et en même temps publications de traductions et d’œuvres originales. Son premier titre (1940) dit le choix déjà fait de l’exil et du don de soi : Ma vie sans moi. Deux ans plus tard, il termine un étrange roman : Le temps qu’il fait. Il y relate les drames dont il fut l’acteur ou le témoin. Cette évocation émouvante peint un univers où la réalité se mêle à la fiction. De 1943 à 1953 les traductions se succèdent ; puis, en 1958, deux volumes de Poésie non traduite à partir d’auteurs chinois, russes, arabes, suédois. Dès ses premiers essais, il a rêvé de “coïncider avec toute la souffrance et toute la joie présente à chaque moment du monde” ».
Ainsi la version bourdonnienne, savamment erronée, de l’itinéraire d’Armand Robin fait-elle désormais foi : le travail d’Armand Robin au ministère de l’Information sous l’Occupation est gommé : le travail d’écoutes est placé avant-guerre, puisque antérieur à la rédaction de Ma vie sans moi, ce qui est faux mais permet de passer sous silence la condamnation par le Comité national des écrivains à la Libération. La mort tragique dans un commissariat de police, thème généralement si apprécié des commentateurs, a, en revanche, disparu : elle devait faire mauvais effet.
Au total, le poète commémorable donne l’impression d’avoir eu pour principale vertu de fuir la ruralité : à force d’acharnement, il a réussi à échapper aux « servitudes du terroir », produit une œuvre « émouvante » et, pour finir, traduit beaucoup de langues.
.
2. L’ÉCRASANTE LOURDEUR DU PONCIF
Tout cela résulte de la fabrique mythobiographique développée par le site de Jean Bescond et la biographie de Lilti. Qu’on prenne la peine de lire cette biographie, on constate que rien n’y manque.
L’enfance douloureuse : « Le père est un homme dur à la tâche et au mal qui mène sa famille à la baguette », « la mère, elle, est douce, aimante et pieuse, travailleuse et entièrement dévouée aux siens », les frères aînés sont forcément « de rudes et solides gaillards », le père, quoique, comme de juste, porté sur la boisson, est, puisque breton, un « barde local » qui « anime les veillées ». À la terrible « incompréhension du père », forcément « source de grande souffrance », répondent les éblouissants bulletins scolaires du petit Armand, les démêlés du génie au collège, avec, en prime, un couplet inattendu sur la révolte des Bonnets rouges qualifiée, au mépris de l’Histoire, d’« autonomiste, voire révolutionnaire », puis l’éternelle antienne sur le monde paysan : « La culpabilité d’avoir choisi le français contre le breton, le monde intellectuel contre le monde paysan le fait énormément souffrir et il ne peut assumer cette souffrance que par la conviction qu’il est chargé de la responsabilité de donner une voix à ceux qui n’en ont pas. » Car, Anne-Marie Lilti l’assure après Alain Bourdon, les paysans n’ont pas de voix. Et les paysans bretons, eux, n’ont même pas de langue : la biographe y revient à maintes reprises et va jusqu’à citer Hugo assurant que le paysan breton « parle une langue morte », « une tombe de la pensée ». Armand Robin est venu d’un monde muet car le breton interdit toute expression autre que rustique : c’est une langue « suffisante certes pour les échanges quotidiens, mais qui ne leur permet pas de se dire poétiquement. »
Il est étrange de voir de farouches défenseurs du breton faire la promotion d’une telle biographie[2] mais en cet aveuglement je vois encore une preuve de la prégnance d’un lieu commun saturant l’espace critique. Alors même que la poésie populaire affleure à tout moment dans Le Temps qu’il fait et dans Ma Vie sans moi, le lieu commun commande : le peuple, c’est Caliban, et le breton le patois des rustres. Au demeurant, on ne cesse de le répéter, ce pauvre Robin venu d’une famille d’illettrés n’a parlé « que le fissel » avant son entrée à l’école primaire (pour écrire sa notice biobibliographique, Bourdon a dû faire appel à un partisan de l’orthographe universitaire, peut-être Fañch Morvannou, qui devait faire une enquête biographique sur Robin). Bourdon a donc appris que le breton parlé à Rostrenen était une forme dialectale — ce qui donne sous sa plume :
« Né le 19 janvier 1912 à la ferme de Kerfloc’h en Plouguernével (C.-du-N.), Armand Robin était le huitième enfant d’une famille de cultivateurs bas bretons. Jusqu’à son entrée à l’école il ne pratique que le dialecte de son pays natal : le fissel. »
Comment Robin aurait-il pu parler breton sans « pratiquer le dialecte de son pays natal » ? « Fisel » (orthographe courante) désigne d’ailleurs une danse plus qu’un dialecte de haute Cornouaille. Robin aurait-il dû parler le breton surunifié ? Parlait-il français avant d’entrer à l’école ? Oui, d’après lui-même, et d’après son frère Hippolyte que j’ai maintes fois interrogé, mais comment des cultivateurs bas bretons qui ne pratiquent qu’un bas dialecte à la dénomination d’ailleurs vaguement ridicule pourraient-ils s’exprimer en français ? L’essentiel est de montrer l’avènement de la perle dans le fumier, et par là de grandir le Poète indésirable.
3. L’OFFICIALISATION DU PLAGIAT
Pour montrer la manière dont, tout à la fois, le lieu commun s’impose comme norme allant de soi, officialisant et normalisant ainsi le plagiat, et fait effet de saturation, empêchant toute compréhension de l’expérience d’Armand Robin en ce qu’elle a pu avoir d’étrange et de vivant, je m’appuierai sur le dernier essai paru sur Armand Robin traducteur. Il s’agit d’ailleurs d’un essai (ou plutôt du chapitre d’un essai) que l’on peut dire officiel puisque son auteur, un professeur d’université qui, à ce jour, n’a produit sur Armand Robin que ce chapitre, va, en tant que spécialiste, rédiger l’article Robin de la grande histoire de la traduction française à paraître sous la direction de Jean-Yves Masson. Ce chapitre, intitulé « Armand Robin, “un étrange étranger” », fait partie d’un essai paru aux éditions Les Belles Lettres sous le titre La Seconde Profondeur, un essai paru dans la collection « Traductologiques » dirigée par Jean-Yves Masson et Jean-René Ladmiral — et l’auteur, Christine Lombez, ne manque aucune occasion de rendre hommage à Jean-Yves Masson.
Le propos de ce livre est, en soi, totalement aberrant, et il est permis de se demander comment un éditeur aussi justement renommé que Les Belles Lettres a pu laisser paraître un tel essai — mais encore une fois, comme dans le cas des éditions Aden, qui avaient publié la biographie d’Anne-Marie Lilti avec le soutien du CNL, le lieu commun fait loi : en l’occurrence, le livre a été subventionné par le « laboratoire L’Amo (EA 4276) de l’Université de Nantes » et l’Institut universitaire de France.
La thèse de l’auteur (je la résume en bref) est que « dans chaque traduction réussie, il y a poème, c’est-à-dire recherche, découverte et mise au jour d’une seconde profondeur » (p. 331). En quoi consiste la première profondeur, on ne le sait pas, et la seconde, non plus. Tout ça se passe par en-dessous et, en fin de compte, « si la traduction de poète (et non plus en poète) se voit entourée d’un si épais halo de mystère, c’est peut-être, finalement, en raison de son pouvoir démiurgique (voire thaumaturgique). » La traduction poétique a une « vertu vivifiante, pour ne pas dire miraculeuse », telle est la conclusion. Il est un peu bêta de dire que la traduction poétique est un miracle, donc on ne le dit pas, mais on le dit quand même. Il est un peu bêta de dire qu’une petite potion de poésie traduite peut remplacer un voyage à Lourdes, donc on ne le dit pas, mais on le dit quand même. Il est un peu bêta aussi d’affirmer que « seuls les poètes peuvent traduire des poètes » mais, quand même, être poète, ça donne de l’« auctoritas », même si, bien sûr, « on peut traduire “en poète” sans avoir une œuvre personnelle à son actif » comme certains universitaires et il y a même d’heureux mortels qui « combinent » « les deux vocations, poétique et professorale » — comme, par exemple, Jean-Yves Masson (p. 331).
Dans la mesure où Robin vient prendre place par ordre alphabétique au nombre de douze poètes qui ont traduit des poètes (donc, aussi saugrenu que cela puisse paraître, entre Rilke et Thomas, je veux dire Henri Thomas), je ne peux pas me dispenser de commencer par constater l’incongruité comique de la méthode : Dupont poète a traduit un poète, c’est donc qu’il a traduit en poète. Tel le ravi de la crèche, l’auteur nous expose ce miracle : Armel Guerne, exécrable poète, exécrable traducteur, prend place à côté de Jean Prévost, poète inexistant, excellent traducteur, de Marina Tsvetaïeva, considérée ici comme traductrice de Pouchkine en français, c’est-à-dire auteur d’une traduction illisible, quoique traductrice de génie en langue russe — car ce qui échappe totalement à cette universitaire, c’est cette réalité bien simple, à savoir que traduire de la poésie suppose prioritairement de maîtriser la langue d’arrivée et que si des poètes peuvent, comme tant d’autres, non pas traduire des poètes mais traduire des poèmes (c’est sur ce mythe du Poète que repose toute cette démonstration), c’est qu’ils disposent des moyens requis pour procéder à ce que Jakobson définissait comme une « recréation créatrice ».
Quelle régression depuis les recherches de Jakobson… alors même qu’il évoquait son travail de traduction de Pouchkine en tchèque avec Nezval qui ne savait pas un mot de russe, cette normalienne en est encore à se demander si l’absence de connaissance de la langue source n’accroît pas le « risque d’opacification » dès lors que tout se passe dans « l’au-delà du signifié » (p. 163). L’au-delà, le miracle, l’assomption — nous sommes dans le pieux registre du génie inspiré par Dieu. Certaines traductions sont, hélas, d’une nullité confondante. Mais ces Poètes ont traduit des Poètes. Guillevic, poète communiste, qui explique comment il traduit à partir d’un mot à mot, des poèmes écrits dans des langues qu’il ne connaît pas, pose problème. En revanche, Robin surgit à tout moment du livre pour nous rassurer : il n’y a pas vraiment de problème car tout se passe ailleurs, dans l’au-delà du mystère. « Poète de toutes les langues (il en connaissait au moins une bonne vingtaine), Armand Robin est donc un défi pour le regard traductologique. » (p. 285).
Où est-elle allée chercher que Robin savait une bonne vingtaine de langues ? Sur quelles recherches s’appuie-t-elle ? En préface de cet essai, elle écrit : « Quant à certaines versions d’Armand Robin qui n’a pas hésité à traduire du hongrois, du chinois, du gallois, de l’arabe entre autres, nombreuses sont encore à ce jour les conjectures sur le véritable niveau du poète en des langues si diverses » (p. 24). Où a-t-elle trouvé des traductions du gallois ? Et quelles sont les conjectures sur « le niveau », comme on dit au collège, de Robin en mongol ou en tchérémisse des prairies ?
Ce qui importe ici, au risque même de la pire sottise, c’est le mythe mis en place, et que tous les éléments viennent grossir selon le modèle bourdonnien passé par Anne-Marie Lilti — car la grande référence, l’unique, à dire vrai, c’est la biographie de ma plagiaire. Le chapitre de Christine Lombez sur Armand Robin est dans sa totalité un hommage à sa collègue : qu’elle ait eu néanmoins connaissance du jugement rendu se voit à la manière retorse de reprendre les emprunts condamnés pour plagiat mais en donnant pour référence (sans la moindre allusion au fait qu’elle me cite) aux Écrits oubliés, aux Fragments, à Poésie sans passeport — quatre volumes qu’elle donne pour publiés tels quels par Robin, sans mention d’éditeur, sans mention de l’auteur des passages qu’elle démarque : mes recherches sont présentes in absentia — et, bien sûr, mis au service des habituelles litanies bourdonniennes, mais plutôt aggravées : « Jusqu’à l’âge de six ans, la langue maternelle de Robin fut un dialecte breton, le fissel ». Sans doute a-t-il changé de langue maternelle après six ans sous le choc bénéfique de la découverte du français… « L’assimilation du français à un âge relativement tardif, lors de l’entrée à l’école primaire, constitua pour lui un choc. » Car, tel l’indigène d’une tribu primitive, le Breton de Rostrenen ignore tout de la langue nationale parlée hors de sa réserve. Par bonheur, le génie de Robin lui permet d’assimiler le français « avec une facilité déroutante » (exploit sidérant de la part d’un bas Breton). Ce pauvre Robin, pris dans un milieu de rustres, se trouve subir « un processus d’acculturation douloureux » qui l’amène à chercher une « langue natale » car, c’est évident, « ni le fissel ni le français » ne peuvent, « contenir sa soif d’absolu, son désir de pureté » (p. 265) et donc il apprend l’allemand, le polonais, le russe, le chinois, l’arabe préislamique, comme ça, en vrac, sous le coup d’une « passion polytraductrice dévorante ». Ensuite, ça devient pour lui un « moyen privilégié de lutte contre une dépersonnalisation qu’il vit avec acuité » ; il la vit même avec tellement d’acuité que « le traducteur prendra le pas définitif sur le poète, ces deux versants de la création poétique ne pouvant visiblement pas coexister en lui ». Retour à l’éternelle bourdonnerie : la poésie à gauche, la traduction à droite et le génie de Robin au milieu qui fait de lui un traducteur faute, hélas, de pouvoir être poète. Mais ça ne fait rien, nascuntur poetae, c’est un Poète et donc il traduit des Poètes.
Le contresens est total, l’incompréhension quant à la non-traduction est celle même que commettait la plagiaire, et l’on retrouve sans surprise le passage au sujet de la fausse « Vie d’Essénine » :
« Placer sur un même plan poèmes personnels et poèmes traduits comme l’avait voulu Robin revient à interroger la nature même de la création poétique ainsi que le statut à donner aux traductions dans l’oeuvre d’un poète. La question est délicate, d’autant que Robin semble lui-même s’être employé à brouiller les pistes. Ainsi, à propos de la « Vie d’Essénine chantée par un paysan russe de la région de Riazan », faut-il parler de « faux poème d’Essénine » ou de « vrai poème de Robin » ? Le doute est d’autant plus permis que ce texte s’est finalement révélé être une pseudo-traduction, autrement dit un poème du cru de Robin (sic) présenté comme traduction. “Je suis le seul responsable de cette vie d’Essénine que j’attribue à paysan russe”, confia d’ailleurs le poète à Jean Paulhan dans une lettre du 16 novembre 1938 (lettre citée in A. Robin, Écrits oubliés II, op. cit. p. 244).
Le plus cocasse (si l’on peut dire) de l’affaire est d’ailleurs que ces deux universitaires se contentent de reprendre une bourde que j’avais commise dans les Écrits oubliés : il n’y a évidemment jamais eu de « faux poème d’Essénine » puisque la « Vie d’Essénine » est un pastiche de chanson populaire russe. La formulation erronée de ma notice des Écrits oubliés est reprise servilement — sans aucune mention de source, bien sûr, dans le cas de ma plagiaire et avec une mention de source visant à dissimuler l’emprunt dans le cas de sa collègue normalienne, parfaitement au fait des pratiques admises par l’université. La référence de la lettre de Paulhan est bien donnée mais à aucun moment mes recherches ne sont mentionnées.
Et tout cela se termine, comme il fallait s’y attendre, par un portrait de Robin en « proscrit, chasseur, braconnier, martyr volontaire ». Robin le disait et le redisait sur tous les tons : il n’existait pas, il n’existait que dans la mesure où, sans existence, il était toutes les existences et était ainsi, écrivait-il dans L’Homme sans nouvelle, « soulagé de l’Armand Robin sur [sa] nuque malgré [lui] posé ». Est-il réellement impossible de prendre en compte son travail pour ce qu’il a été et pour cette tentative d’effraction dans un domaine si soigneusement gardé ? Oui, force est de l’admettre.
Vingt ans de travail pour rien — non bien pis que rien : une véritable tromperie visant à faire de ces recherches le matériau d’une conception réactionnaire de l’écriture et de la traduction — la chose est un peu difficile à admettre, c’est certain. Mais l’hommage au plagiat ainsi rendu a du moins le mérite d’inciter à mieux comprendre quels mythes vétustes continuent d’alimenter l’institution littéraire : Armand Robin sert à réactiver la figure du poète maudit, à étayer une conception théologique de la traduction reposant sur une mystique héritée du romantisme. « Appelé à refaire le parcours d’écriture de l’auteur original (“le poème est recréé, mais à partir de sa fin, en remontant vers sa pure origine”, pour reprendre les mots superbes d’Armand Robin), le passeur est celui qui saura — c’était déjà le vœu des romantiques allemands — s’approcher de l’Idée même de l’œuvre source… » L’Idée, le miracle, l’accès à l’ineffable, et le tout en s’appuyant sur des falsifications qui, même condamnées en justice, servent de référence : il ne s’agit pas de donner à comprendre mais de donner à croire, y compris au mépris des faits, des textes et des recherches habilement passées sous silence comme hérétiques. Dans la perspective d’une apologétique, la contrefaçon n’a pas lieu d’être blâmée : pour peu qu’elle serve le dogme, elle peut même passer pour méritoire. Le mythe du Poète se nourrit du mépris du texte. Et c’est ce mépris du texte qui explique tout à la fois le grand n’importe quoi de la traduction et l’indifférence au plagiat.
.
© Françoise Morvan
.
[1] Lettre à J. Paulhan, 3 décembre 1940.
[2] Ainsi Fañch Broudic : http://languebretonne.canalblog.com/tag/Armand%20Robin
.
.
*
Pour en savoir plus, il est possible à présent de lire l’essai paru en décembre 2020 aux éditions Garnier, Armand Robin ou le mythe du Poète.
.
.
.