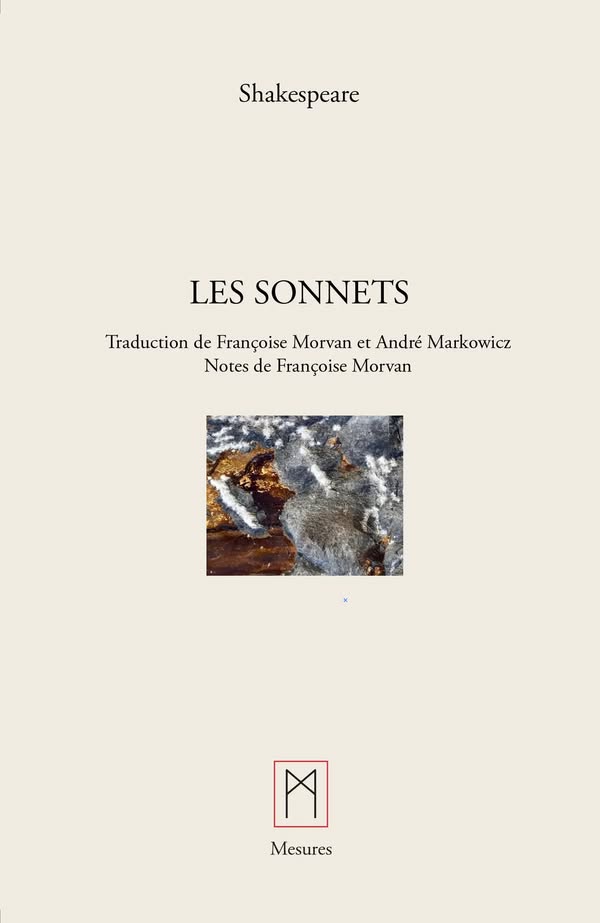.
.
Après notre week-end de travail à l’ADEC sur les sonnets de Shakespeare, André a publié une chronique sur Facebook qui rendait compte de cette expérience amicale, passionnante et joyeuse, et il en a profité pour évoquer une autre expérience amicale, passionnante et joyeuse menée par David Gauchard (dans le prolongement de son travail sur Shakespeare et plus précisément sur les sonnets avec des lycéens). André a intitulé sa chronique « Ce qui fait vivre ». Je me contente de la reproduire ici pour ceux qui (comme moi) ne sont pas sur les réseaux sociaux. J’ajouterai que ce qui est touchant est la manière dont ce livre vit sa vie depuis le cœur de notre microscopique maison d’édition et de cercle en cercle touche des personnes qui ne le savaient pas et nous sont proches.
.
Ce qui fait vivre
Pendant deux après-midis, Françoise et moi, nous avons travaillé à l’ADEC de Rennes, – avec des amateurs, donc, – sur l’invitation d’Élise Calvez, sur des sonnets de Shakespeare. Nous avons travaillé, et nous serions encore, ce matin, sur un nuage si nous vivions hors du monde.
Ils étaient dix-huit, hommes et femmes, de tous âges – et nous ne les connaissions pas (nous connaissions, par hasard, juste un des stagiaires). Nous avions demandé qu’ils aient notre édition, – c’est tout. – L’idée était toute simple : ils choisissent un sonnet, et ils le lisent. C’est à dire qu’ils le disent. Les uns après les autres. – Ils les disent et, les disant, nous les explorons ensemble, nous essayons de les comprendre, de montrer la structure, – et, à chaque fois, évidemment, nous revenons à la source même de notre traduction, au travail sur le son, puisque, littéralement, les sonnets, ça doit sonner, et les sonnets de Shakespeare, destinés à la lecture des yeux (à l’inverse de ses pièces, qui ne n’existent, pour lui-même, que par la scène et en dehors de la parole écrite), sont aussi, et surtout, conçus par être lus à haute voix, tellement la structure sonore en est intense, riche, totalement musicale, – sauf que cette lecture n’est pas une lecture sur la scène : non, c’est une voix portée de l’un vers l’autre, une voix intime, la voix d’une personne donnée. Lire, donc, c’est d’abord essayer de comprendre, – et, s’agissant d’une traduction, et puisque nous le disions en français, revenir à la compréhension, instinctive, que nous, Françoise et moi, avions eue de chaque texte pour arriver à celui que nous proposons au lecteur, et donc confronter cette compréhension, à trois ans de distance aujourd’hui, puisque notre édition est parue en 2022, avec l’original. Comprendre et, en même temps (pas d’abord, non, en même temps), dire, – c’est-à-dire faire comprendre ce que nous avons compris, dire, c’est-à-dire d’abord, évidemment, faire entendre la structure, le mètre, la construction d’un sonnet anglais (très différente de celle des sonnets français), – trois quatrains et un distique de conclusion ou de retournement, avec ce renversement obligatoire, d’une façon ou d’une autre, au début du troisième quatrain, mais aussi, à chaque fois, faire attention à la matière sonore, aux allitérations, soulignées ou non (et il est rare que nous les soulignions, – parce que Shakespeare ne les souligne que très rarement), bref, essayer de donner à chaque stagiaire la sensation d’une matière organique, dans laquelle le sens lexical des mots n’est qu’une partie du sens, avec la mémoire des images et la matière sonore, et le jeu du mètre avec le rythme. Leur donner cela, – en très peu de temps, c’est si peu, finalement, sept heures de travail effectif en tout – et, en même temps, essayer de comprendre comment, en eux, – à chaque fois d’une manière différente, – il est possible de trouver une voix, – une voix que, très souvent, ils ne soupçonnent pas, ou ne pensent pas qu’ils ont, – comment poser la mélodie du vers, poser les mots devant les autres, comment rendre évident ce qui, soudain, ou pas soudain (ou bout de trois ou quatre essais) leur est, à eux, devenu évident.
Nous avons travaillé sur, donc, dix-huit sonnets, qu’ils ont choisis, et, hier, Françoise a proposé un ordre de lecture, pour revenir au mystère de ce livre, – à ce qu’elle appelle ce roman éclaté qu’il contient, – l’amour d’un homme d’âge mûr envers un « doux garçon », visiblement de la haute noblesse, – un garçon dont tous les érudits cherchent à savoir le nom (mais l’humour, sidérant, de Shakespeare est de dire qu’il le rendra célèbre, sans jamais le nommer, et donc, nous ne savons pas qui c’est), – un amour sombre, plein de péripéties, avec cette espèce de ménage à trois avec « dame sombre » (dark lady), un amour qui passe par les intonations les diverses, lumineuses, ironiques et, le plus souvent, terriblement noires, – mais, en même temps, de cet amour mystique, affirmé comme une prière quotidienne. Et, je le dis comme c’est, c’était bouleversant de voir ces stagiaires travailler, de les voir s’offrir, les uns aux autres (je ne sais pas si tous se connaissaient avant, – sans doute pas), des textes magnifiques. Et puis, il y en avait parmi eux qui parlaient un anglais formidable, et, donc, ils lisaient, eux, deux textes – le texte anglais, et le texte de notre traduction. C’était, oui, magnifique.
La veille au soir, dans la – formidable bibliothèque de l’ADEC, – qui présente des milliers de livres de théâtre, – Elise Calvez a mené une discussion avec nous, sur la traduction, – la traduction du théâtre, mais aussi sur cette entreprise qui, aujourd’hui, prend toute notre vie en miroir, – les éditions Mesures. Et le monde qu’il y avait, et les questions posées, et cette chaleur humaine qui se dégageait, vraiment, nous étions très touchés.
*
Nos sonnets de Shakespeare chez Mesures, ils continuent de vivre. David Gauchard, de la Compagnie de L’Unijambiste, au gré des tournées (beaucoup trop rares) du Macbeth qu’il a monté (et, oui, je pense que cette mise en scène est un chef d’œuvre, j’en ai parlé, ici, il y a bientôt deux ans, pour la création à Quimper), travaille avec des classes de lycée, sur Shakespeare, avec ses amis et ses acteurs, – ici ARM, et Emmanuelle Hiron (qui n’est pas sur le spectacle). Ils travaillent sur les sonnets de Shakespeare que nous avons traduits, – c’est-à-dire qu’ils les font lire aux élèves, avec une musique originale, créé, à chaque fois, quasiment en direct, par ARM, – musique interprétée aussi par les élèves selon les possibilités. Et imaginez ce que nous avons découvert, – vous l’avez dans l’image qui illustre cette chronique (il faut scanner le QR code pour entendre) : ils étaient à Perpignan, pour deux représentations. ARM et Emmanuelle ont travaillé comme ça, pour arriver, avec des élèves de seconde (!…) à ce qu’ils aiment ces textes, et qu’ils les disent, eux aussi, pour ce qu’ils sont, une poésie sublime, qui leur parle à eux, d’une façon ou d’une autre, – et j’insiste sur ça : on ne leur parle pas de leur propre vie dans « les quartiers » (et Dieu sait qu’il y aurait quoi dire à Perpignan), non, on ne leur parle pas d’eux de l’extérieur (et c’est ce que je déteste, le plus souvent, dans les interventions « périscolaires », quand des artistes, hors venus, viennent parler aux jeunes de la vie des jeunes – une forme, finalement, de paternalisme colonial, dont les élèves sentent mieux, le plus souvent, les implications que les intervenants eux-mêmes). Non, on leur parle d’un étranger total, – des sonnets écrits en 1600, – et on les fait entrer dedans, et c’est cette confrontation, organique et bienveillante, avec un étranger total qui les approfondit eux-mêmes, au sens où elle leur fait découvrir, en eux, des profondeurs et des dons qu’ils ne soupçonnaient pas. Qui les rend plus forts, plus présents, à eux-mêmes et aux autres. C’est ce travail qui met la poésie, nous dirons ça comme ça, dans la cité. Sans les flatter dans le sens d’aucun poil, sans nulle exaltation d’un misérabilisme, sans nulle revendication identitaire. Juste ça : des voix, uniques et ensemble, pour dire ce qui est beau, – et, le sentir ensemble, et chacun en lui-même, que, oui, c’est beau : pas seulement ces sonnets, mais eux qui les ont dits. Oui, ils sont beaux. Tous.
C’est ça qui rend vivant.
Parce que nous sommes morts si, dans la lutte quotidienne pour une cause, ou juste pour la vie au jour le jour, nous oublions le but : nous sommes vivants quand nous sentons que c’est beau. Quoi que ce soit, ce « beau ». Et oui, je le dis comme je le sens, c’était beau d’entendre ces amateurs de l’ADEC, et c’est beau d’entendre ces élèves, – que je ne connais pas, que je ne verrai jamais. Et vous n’imaginez l’émotion que c’est, pour Françoise et pour moi, de savoir que, chacun et chacune, David Gauchard leur a offert un exemplaire de notre édition. Un livre qu’ils ont contribué à faire vivre.
.
.
À titre informatif, j’ajoute que notre travail pour l’ADEC nous a amené à constater que notre édition des Sonnets était absente de toutes les bilbiothèques de Rennes (à part celle de l’ADEC). On ne les trouve ni aux Champs libres ni à la Bibliothèque interuniversitaire (la censure est d’ailleurs volontaire puisque sur les 32 titres des éditions Mesures, seul le recueil des contes de Luzel a été retenu, sans doute parce qu’un lecteur en a fait la demande).
Aux Champs libres, si l’on cherche Clair soleil des esprits, qui prolonge la traduction des Sonnets, on tombe sur un recueil de chants scouts. Inutile de chercher ma traduction de Roméo et Juliette, qui est aussi le prolongement des Sonnets, bien qu’il y ait aux Champs libres plus de vingt éditions, y compris les pires adaptations, et à la BIU, 2 489 résultats si l’on s’intéresse aux Sonnets de Shakespeare.
La seule solution pour que nos livres soient présents en bibliothèque est que les lecteurs fassent une demande d’achat et soient prêts à la renouveler… Bon courage !
.