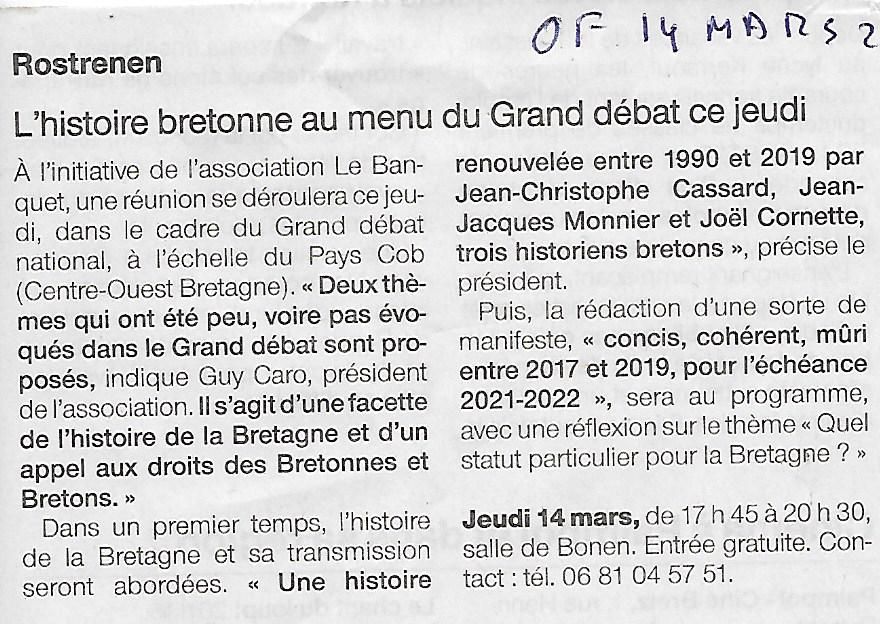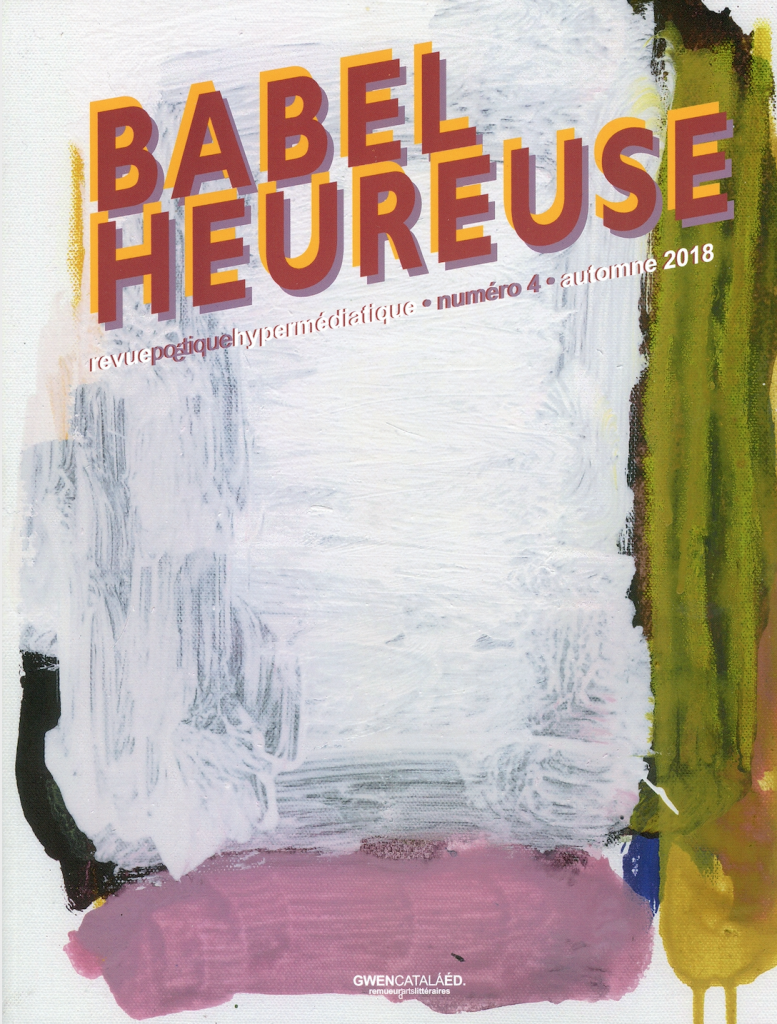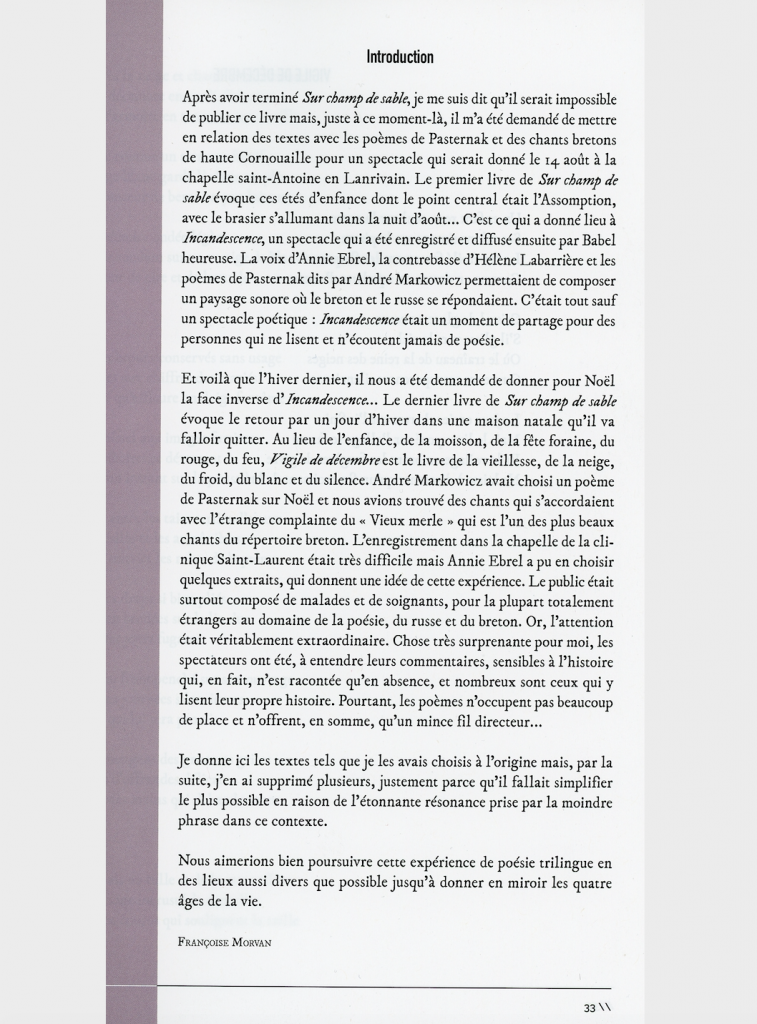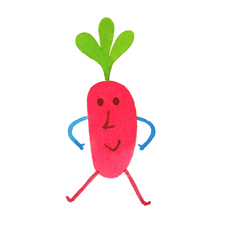Comme pour prolonger nos rencontres aux rendez-vous de l’histoire à Blois, je découvre ce matin (signalé par un lecteur vigilant) un article du Monde qui, d’un côté, me réjouit et, de l’autre, me laisse, une fois de plus, sceptique.
Il me réjouit car, pour la première fois, le rôle de celui que les médias désignent à l’unisson comme l’« ultranationaliste » (ou l’« hypernationaliste ») breton est mis en lumière et ses liens avec la Russie pris en compte – et puis, pour la première fois aussi, le procureur de la République est décidé à agir… Voilà un heureux épisode du feuilleton que je déroule depuis dix ans maintenant, notamment pour le site du Groupe Information Bretagne où j’en suis les développements avec une constance que rien ne lasse, pas même le dégoût.
Tout a commencé en 2008 quand j’ai découvert qu’un nationaliste breton dissimulé derrière un pseudonyme diffusait des propos racistes tout en me traitant de « militante fasciste ». Bizarre mélange… Sa prose, incohérente, verbeuse, charriait des resucées de lectures restituées au hasard, des lieux communs pris dans le vieux fonds du nationalisme d’après-guerre, des digests mal assimilés, sur fond de haine raciale inspirée par la celtitude mystique plongeant dans le sang pur de l’ethnie à préserver de toute souillure. La nation bretonne était surtout menacée par les Juifs mais aussi par moi, du fait que j’avais publié des contes aux éditions Ouest-France…
Pour ce qui me concernait, cette prose était très proche de celle de Breizh infos, alias Bretagne hebdo, que j’avais fait condamner pour diffamation et qui avait disparu : il me semblait que le rappel à la loi pouvait avoir une vertu salubre et, constatant que mon insulteur tenait des propos antisémites (il appelait notamment à l’instauration d’un statut pour les Juifs), après avoir porté plainte pour moi-même, j’ai fait la synthèse de ses divers articles et j’ai alerté la LDH.
Au terme de longs débats (car, après tout, à quoi bon donner de l’importance à des illuminés ? Ne vaut-il pas mieux les ignorer ? Tout ça a si peu d’importance en regard de la situation des émigrés, etc., etc.), la section de Rennes a fini par constituer un dossier, alerter le service juridique de la LDH qui a porté plainte à son tour. Entre-temps, ma plainte en diffamation avait permis d’identifier un crêpier de Rosporden du nom de Boris Le Lay. Depuis, il ne serait plus identifiable puisqu’il a fait héberger ses sites aux USA. Je ne regrette donc pas d’avoir engagé cette procédure. La LDH, ainsi informée, a pu le faire condamner une première fois à Paris. Nous avons essayé de trouver des journalistes qui s’intéressent à ce procès : en vain.

C’est quand Boris Le Lay s’en est pris sur son site Breiz Atao à des sonneurs noirs que, soudain, les médias se sont mobilisés. Les bons nationalistes qui défendaient Polig Monjarret, le fondateur de Bodadeg ar Sonerion dont faisaient partie les sonneurs noirs, avaient soudain une merveilleuse occasion de montrer comme ils étaient antiracistes et démocrates. Rappeler que Monjarret était un nazi et que Le Lay ne faisait que prolonger l’idéologie de Breiz Atao dont il se réclamait en toute logique fasciste était également inutile : la presse bretonne avait mis au point un concept nouveau, forgé pour Le Lay, à savoir le concept d’« ultranationalisme ». L’ultranationalisme, excessif, comme le nom l’indique, et susceptible de dérives imprévisibles (le cas Le Lay le montre) a pour effet premier de normaliser le nationalisme qui a, lui, figure aimable. Nous avons donc un méchant, raciste, haineux, qui permet aux nationalistes bretons de passer pour ouverts et porteurs d’un projet d’avenir. Ils devraient le remercier.
Comme je le rappelais sur le site du GRIB, au moment où l’« ultranationaliste » était condamné une nième fois, paraissait à l’occasion du salon de livre de Carhaix fondé par des nationalistes une luxueuse anthologie des textes de Breiz Atao – anthologie que l’on trouve désormais dans la plupart des bibliothèques de Bretagne – publiée par les éditions nationalistes Yoran Embanner.

Aucun rapport entre ces productions et celles de l’«ultranationaliste » Le Lay ? Mais si : elles reposent sur le même soubassement idéologique, et c’est en toute logique que Le Lay se réclame de Breiz Atao.
Seulement, il est interdit de le dire car cela reviendrait à remettre en cause tout le mouvement breton, au moment même où les élus adoptent son discours, ses symboles et même ses pires références : il n’est que de voir, dernière en date, la cérémonie au cours de laquelle, à Saint-Aubin-du-Cormier, le président du conseil régional, supposément socialiste puisque remplaçant le supposément socialiste puisque élu comme tel quoique plus socialiste Le Drian, venir saluer l’érection d’un archer anglais venu défendre l’indépendance de la Bretagne contre la France hélas victorieuse…

Marc Simon, Laurence Jacquet, le maire Olivier Barbette, Le président de Région Loïg Chesnay-Girard et Jérôme Jacquet à côté de l’archer anglais
Grotesque, oui, comme la Vallée des saints, comme les lieux de culte identitaire appelés à former une espèce de Breizh parade dont Le Lay serait le chef d’orchestre invisible…
C’est pour cette raison que j’ai évoqué à Blois cet enrôlement de la Bretagne dans une croisade identitaire sous drapeau, croisade identitaire dont il est, en fin de compte, le meilleur atout.
Je me réjouis donc de lire l’article du Monde, mais je constate que le site breiz atao n’est pas même mentionné, que le noyau de l’idéologie de Le Lay, qui n’est pas même qualifié de nationaliste, est ignoré, et qu’une fois de plus, l’action déclenchée contre le site DemocratieParticipative.biz laisse toute analyse idéologique en déshérence.
Nous en sommes toujours au point où, voilà dix ans, face à la section de la LDH, je me heurtais au mépris de ceux qui considéraient que tous ces, comment dire, régionalistes, autonomistes, séparatistes bretons étaient des illuminés à laisser de côté sans leur donner une importance qu’ils n’avaient pas. S’ils ne l’avaient pas, ils l’ont prise, et sans attendre qu’on la leur donne.
C’est la lâcheté, l’indifférence et l’aveuglement qui font le lit du fascisme, puis cette certitude d’avoir à regarder ailleurs au moment où il s’agirait d’agir.
En tout cas, voici cet article tel qu’on peut le lire en ligne:
LE MONDE | 18.10.2018 à 00h53 • Mis à jour le 18.10.2018 à 08h39 |Par Elise Vincent et Martin Untersinger
C’est une première en France. Le procureur de la République de Paris, François Molins, a assigné en référé les opérateurs de télécommunications afin qu’ils bloquent un site internet d’extrême droite publiant des contenus haineux en ligne, a confirmé au Monde une source proche du dossier, mercredi 17 octobre.
Cette démarche inédite sur la Toile, résultat de mois d’aléas judiciaires, est particulièrement portée par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), organisme rattaché au premier ministre.
En vertu de cette assignation, neuf opérateurs, dont les quatre principaux – SFR, Orange, Free et Bouygues Telecom – sont assignés, le 8 novembre, au tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de cette procédure d’urgence.
L’objectif : constater le trouble « manifestement illicite » causé par ce site, selon les mots du parquet de Paris, et ordonner de cette façon le blocage de l’accès à la plateforme dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.
Un site sans équivalent à l’extrême droite
Le site en question porte très mal son nom : il s’appelle « DemocratieParticipative.biz ». Sur ses pages se déploie une litanie d’articles et de vidéos antisémites, homophobes, antimusulmans et racistes.
Ce site, qui se revendique « le plus lu par les jeunes blancs décomplexés », agonit aussi régulièrement d’injures divers responsables politiques et personnalités médiatiques. Au point de servir souvent de base arrière à des campagnes de harcèlement numérique d’une rare violence. Par sa radicalité, « DémocratieParticipative.biz » n’a pas d’équivalent dans la nébuleuse d’extrême droite.
Bien que repéré depuis de longs mois, l’activisme du site, créé en 2016, défiait tous les recours juridiques. Les divers signalements effectués par Frédéric Potier, le préfet délégué à la tête de la Dilcrah, par la voie de l’article 40 au parquet de Paris, ne trouvaient pas d’issue judiciaire. Même chose pour près d’une dizaine d’enquêtes diligentées par différents services de police après des signalements sur la plateforme Pharos du ministère de l’intérieur dédiée aux contenus illicites circulant sur le Web, ou des plaintes déposées dans différents départements de France.
Un hébergement américain
Les autorités françaises – ainsi que plusieurs particuliers et associations – ont bien essayé de contourner ces échecs en tentant de limiter l’impact de « DemocratieParticipative.biz » en le faisant par exemple supprimer des résultats de recherche Google. La Dilcrah a même obtenu, en janvier, la disparition de la page d’accueil de « DemocratieParticipative.biz » du moteur de recherche. Une solution néanmoins très partielle, puisque le site est resté en ligne.
Au cœur du problème : le lieu d’hébergement de « DemocratieParticipative.biz ». Pour abriter sa structure, le site a depuis ses débuts recours à une société américaine, Cloudflare. Celle-ci n’a jamais donné suite aux réquisitions françaises. Elle s’abrite derrière le premier amendement de la Constitution des Etats-Unis, qui protège de façon extensive la liberté d’expression, et derrière l’absence de contrainte légale l’obligeant à répondre à des autorités judiciaires autres qu’américaines.
LIRE AUSSI : La guerre discrète de la « preuve numérique »
Autre difficulté : l’identification et l’éventuelle interpellation de l’administrateur du site. D’après une note conjointe de la Direction générale de la police nationale (DGPN) et de la préfecture de police (PP) datant d’avril, que Le Monde a pu consulter, de nombreux éléments permettent de penser u’il s’agit d’un militant d’extrême droite d’origine bretonne très connu de la « fachosphère » : Boris Le Lay, né à Quimper et âgé de 38 ans, suivi sur Facebook par plus de 120 000 personnes et par plus de 10 000 abonnés Twitter.
Des soupçons sur une figure de proue de la « fachosphère »
Selon cette note de la DGPN et de la PP, « plusieurs éléments concordants »désignent en effet M. Le Lay. Le plus fiable étant une adresse IP commune à DemocratieParticipative.biz et à deux sites ouvertement gérés par ce militant, signe que les trois plateformes étaient présentes sur le même serveur informatique. Un élément qu’a pu confirmer Le Monde de façon indépendante.
Fin septembre 2017, la fachosphère avait brui de la « censure » de DemocratieParticipative.biz : il avait, effectivement, disparu du Net, sans explications. Fait troublant, les deux sites appartenant à M. Le Lay se sont évaporés au même moment.
Or sur sa page VKontakte, un réseau social russe, M. Le Lay avait alors répondu à une admiratrice qui s’inquiétait de la disparition de DemocratieParticipative.biz : « On doit reconstruire l’architecture », écrivait le militant. Quelques jours plus tard, ces trois sites changeaient d’hébergeur, et pratiquement en même temps, selon les données techniques consultées par Le Monde.
- Le Lay est loin d’être un inconnu pour les services de police. Il a de nombreux antécédents judiciaires pour« diffamation », « apologie de crime », ou « injure », et a été plusieurs fois condamné, entre 2011 et février 2018. Son parcours militant est aussi éloquent. D’abord engagé dans un groupuscule indépendantiste breton proche de l’ultradroite identitaire, Adsav (Renaissance), il fonde, en 2006, l’association Breizh-Israël qui a pour objet « la promotion des liens entre l’Etat d’Israël, la communauté juive mondiale et les Bretons ». Il bascule plus tard dans l’antisémitisme en rencontrant l’essayiste nationaliste Hervé Ryssen. Il s’occupera aussi un temps « des relations avec l’Europe » du Mouvement des damnés de l’impérialisme du très controversé Franco-Béninois Kemi Seba.
Treize mandats de recherche et une fiche S
Aujourd’hui, la justice bute toutefois sur la fuite au Japon de M. Le Lay. Malgré les treize mandats de recherche et la fiche « S » dont il fait l’objet pour son appartenance à la mouvance d’extrême droite radicale, impossible jusqu’à présent d’obtenir son extradition.
Ces mandats ont été émis pour « injures publiques envers un particulier en raison de sa race, religion, ou origine par parole, écrit, image, ou moyen de communication au public par voie électronique ». Mais il faudrait que M. Le Lay soit contrôlé sur le territoire français ou européen pour qu’ils soient exécutables.
En janvier, une notice rouge d’Interpol a fini par être diffusée pour qu’il puisse être interpellé à l’étranger, dans d’autres pays. Mais la valeur accordée à ces notices varie selon les Etats. Pour des raisons propres à son droit national, le Japon ne peut procéder à une arrestation demandée par d’autres pays membres. Il n’existe, en outre, pas de convention d’extradition entre la France et l’Archipel. Les services de police de l’Hexagone s’inquiètent enfin du fait que M. Le Lay ait pu obtenir, entretemps, la nationalité japonaise. Bref, un casse-tête qui explique la décision du parquet de Paris d’employer les grands moyens.
27 novembre
Le TGI de Paris bloque le site DemocratieParticipative. Le site breizatao reste actif. Et, comme de coutume, on évoque à ce propos « l’ultranationaliste ».
Le fait que les activités de Le Lay soient une expansion de l’idéologie de Breiz Atao semble voué à passer pour donnée adventice…