.
Lu dans Libération ce jour :
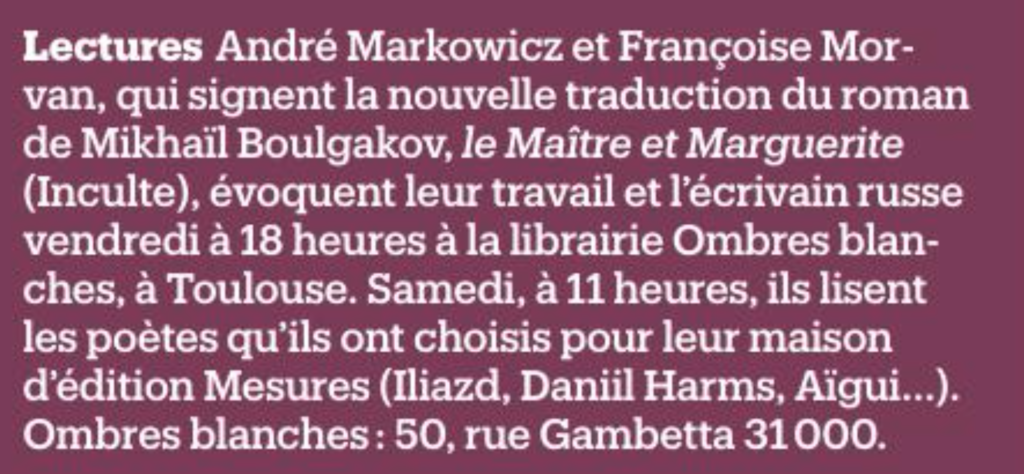
.
En 2008, à l’occasion de la mise en scène de La Cerisaie par Alain Françon à la Comédie française, nous avons participé, André Markowicz et moi, à une rencontre à l’ENS de Lyon sur le thème « Traduire La Cerisaie ». Cette rencontre avait été enregistrée, transcrite et mise en ligne avec des extraits de lecture.
Il se trouve que La Cerisaie, dans la mise en scène de Tiago Rodrigues, avec Isabelle Huppert, va faire l’ouverture du Festival d’Avignon (si les dieux y consentent) et que nombreuses sont les questions que l’on nous pose sur la traduction. Or, nous avons découvert que l’entretien avait disparu du site de l’ENS.
Par chance, une amie en avait pris copie et j’ai pu en mettre en ligne ici une version abrégée.
Cette recherche n’a pas été inutile car j’ai pu corriger certains détails, j’ai retrouvé des photos que j’avais prises à Melikhovo, le domaine de Tchekhov, et j’ai été surprise de voir à quel point elles éclairaient les arrières-fonds de La Cerisaie.
.
Eh oui, avec ce septième et dernier album, l’aventure des Mistoufles, commencée dans l’allégresse, se termine dans la mélancolie – mais le fait que ce dernier album ait pu être enregistré relève de l’exploit : confinement, reconfinement, classes divisées, masques, nouvelles directives, soucis et resoucis…
Le travail à l’école primaire d’Adainville avait formidablement bien commencé. J’en avais un peu parlé ici à l’époque en expliquant pourquoi j’avais choisi de conclure les Mistoufles par un album de Fabulettes, des petits poèmes avec moralités, formant pour finir comme la moralité de cette expérience. Et puis, tout s’est arrêté.
À l’automne, grâce à l’enthousiasme et à la ténacité de tous, les liens ont été renoués.
.
.
Les enfants ont appris et enregistré les fabulettes mises en musique et le disque sera donné le 11 juin aux enfants et aux parents.
Cette année encore, les images de Dan Ramaën ont donné présence aux visages et aux instants partagés.
.
.
Un bel acte de résistance et d’optimisme contre l’adversité.
Je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre la « Chanson de l’escargot du bas du bois » qui s’accorde bien à l’époque et à cette mélancolie que les enfants ont su rendre joyeuse.
.
.
À la fin de la dernière représentation de Désir sous les ormes au Théâtre des amandiers, Jean-Marc Stehlé, qui n’était pas seulement un prodigieux acteur mais aussi un scénographe et décorateur (il jouait le rôle du père dans cette pièce et avait dessiné les costumes) me disait qu’il n’y avait pas lieu d’être mélancolique de voir un spectacle s’achever.
— Pour moi, le plus beau moment d’un spectacle, c’est quand je casse le décor, c’est fini, c’était bien, basta, la vie continue.
J’ai été tellement stupéfaite que j’ai pensé qu’il blaguait. Mais non.
Pour moi, le moment le plus émouvant d’un spectacle, c’est quand tout le monde arrive, se rassemble et que le spectacle qui n’a pas commencé est déjà là comme une énigme que chacun va tenter de résoudre.
Ici, c’est le premier instant de La Cerisaie aux ateliers Berthier. Un instant particulièrement émouvant pour tout le monde puisque la réouverture des théâtres coïncide avec ces répétitions et que le Festival d’Avignon ouvrira avec cette Cerisaie, miracle fragile auquel tout le monde veut croire.
.

.
Trois millions de Bretons, treize millions de cochons… treize millions de cochons abattus par an (d’après Uniporc Ouest), combien de Bretons accablés de voir les eaux polluées, les terres souillées, les paysages ravagés, les villages empuantis par des odeurs de lisier…
Mais protester, c’est nuire à la Bretagne : le touriste a besoin de jouir d’une image positive de cette région vouée à ses vacances. Plus grave, protester en replaçant le phénomène dans son histoire et son contexte, c’est nuire à l’avenir de la Bretagne (pour reprendre le titre du journal de l’autonomiste Fouéré) et donc commettre un crime de lèse-nation. Soupirer, lever les bras au ciel, gémir sur le coût de l’eau en bouteille et sur la mort des alevins est légitime et même bien vu, mais essayer de comprendre les causes du désastre, holà !
En 2002, lorsque j’avais publié Le Monde comme si, l’avocat nationaliste du journal non moins nationaliste Bretagne hebdo, qui avait orchestré une violente campagne de presse contre moi, m’avait prise à partie au motif que mon chapitre « Le porc ou la mort » où je mettais en cause le CELIB, Martray, Gourvennec et le règne du cochon n’avait rien à faire avec le mouvement breton, le bon mouvement breton si naturellement pur : nulle collusion avec les nazis sous l’Occupation, nulle collusion avec le lobby capitaliste mis en place par l’Institut de Locarn, héritier du CELIB. Blanc comme neige, le mouvement breton odieusement noirci par moi s’était révolté par la voix de Bretagne Hebdo et je n’étais pas fondée à demander réparation puisque c’est moi qui étais coupable, ayant transgressé un double interdit.
Il n’empêche que ce journal a été condamné et a disparu.
Moi aussi : je suis devenue un auteur breton sans existence.
Mais le fait d’être interdite de parole sur le sol breton ne m’empêche pas d’exister ailleurs, et de donner mon avis sur divers sujets lorsqu’on m’interroge. Ainsi lors de la pseudo-révolte des Bonnets rouges, précisément orchestrée par le lobby patronal breton, qui avait donné lieu à une formidable série d’émissions de Charlotte Perry sur France-Inter.
Ainsi, sur France-Inter encore, hier, à l’occasion du dernier désastre écologique en date, la pollution de la Penzé, une petite rivière près de Morlaix… Une fuite de lisier, une de plus, et la rivière est polluée jusqu’à l’estuaire. Rien que de banal en Bretagne. Ce qui l’est moins, c’est que l’habituelle protestation contre ce que la presse régionale appelle un « incident » trouve un relais dans les médias nationaux.
Je regarde qui est l’éleveur. SA Kerjean, Taulé. Pas besoin de chercher bien loin : la SA Kerjean a été fondée par Marc Gourvennec.
En 2003, mis en accusation par l’association Eaux et rivières, le fils d’Alexis Gourvennec s’indignait vertueusement – et ses protestations étaient aussitôt relayées par Le Télégramme : « “Les allégations d’Eau & Rivières ne sont qu’un tissu de mensonges mais leur attitude ne m’étonne pas. Ils veulent nous faire passer pour des grands bandits et cela fait dix ans que cela dure”. Attendant sereinement le vote du conseil municipal de Taulé, le 24 janvier, Marc Gourvennec se défend aussi de vouloir gonfler les effectifs de son exploitation. ”Nous ne les avons jamais augmentés depuis 1988 et je peux garantir qu’avec ce projet de traitement, il n’y aura pas un cochon de plus chez nous” ».
En 2003, l’élevage comptait 11 288 cochons ; actuellement, il en compte 21 000.
Il y aurait encore long à dire sur la pisciculture, sur Brittany Ferries et autres sujets apparemment étrangers au débat mais n’épiloguons pas.
En 2007, Marc Gourvennec meurt. Voici sa nécrologie d’après Ouest-France :
« Fils de l’ancien P-DG de la Brittany Ferries, disparu le 19 février dernier, Marc Gourvennec dirigeait la Sofalim, entreprise d’aliments pour animaux de ferme, dont dépendent deux autres sociétés : la SA Kerjean (élevage porcin) et Financières la Garenne (organisme de placement en valeurs immobilières). Ces trois sociétés familiales sont basées à Taulé. A la fin des années 90, Marc Gourvennec avait pris la direction de la société piscicole Aquadis, qui regroupait plusieurs piscicultures dans la région morlaisienne, mais aussi à Pont-Calleck, dans le Morbihan. Il y a quelques années, il avait intégré le conseil d’administration de la Cuma (coopérative d’utilisation de matériel agricole) de Locmaria-Plouzané. Les obsèques de Marc Gourvennec seront célébrées aujourd’hui, à 14 h 30, à l’église de Taulé, cette commune d’où il était originaire et à laquelle il était viscéralement attaché. »
Qui oserait s’en prendre à ces bienfaiteurs de leur commune, du Léon et de la Bretagne tout entière ? Et qui oserait rappeler que c’est en 1961, avec la prise de sous-préfecture de Morlaix par Alexis Gourvennec qu’a commencé la grande dérive productiviste, induite et soutenue par le mouvement nationaliste breton, terroristes du FLB œuvrant pour l’appuyer, comme le notait Jean Bothorel, qui savait de quoi il parlait ? Du CELIB à Produit en Bretagne le réseau s’est étendu, renforcé, et règne à présent sur les médias, l’économie, la politique, la culture. Face à ce pouvoir exercé sous les dehors de la vertu mise au service de l’identité, voire de l’écologie, qui oserait protester ?
Eh bien, si, le miracle est là : malgré cette chape de plomb, quelques voix s’élèvent encore.
On peut lire un résumé de l’affaire par deux journalistes de Franceinfo…
Et écouter l’émission d’Antoine Chao sur France-Inter.
.
La captation de Crise de Nerfs sera diffusée pour la première fois le vendredi 16 avril à 21h sur la chaîne Olympia TV.
Sous ce titre, Peter Stein a rassemblé trois « petites pièces » de Tchekhov (dans notre traduction) : Les Méfaits du tabac, La Demande en mariage et Le Chant du cygne.
La mise en scène rassemble Manon Combes, Loic Mobihan et Jacques Weber.
.
Demain, à 20 h. France Culture diffuse Eugène Onéguine dans la mise en scène de Jean Bellorini.
En mars 2019, Jean Bellorini, qui dirigeait alors le Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis, a tenu ce pari improbable de déployer pour un public populaire les milliers de vers du roman de Pouchkine ; or, non seulement le pari a été tenu mais le succès a été triomphal et, nommé à la direction du TNP à Villeurbanne, Jean Bellorini, en dépit du confinement, a tenu à reprendre Eugène Onéguine.
Dans l’impossibilité de jouer pour le public, il a, du moins, donné une représentation pour les élèves (puisque les activités pédagogiques sont autorisées) et, grâce à France Culture, prolongé ce temps de partage.
Je vous invite à lire la présentation de cette émission sur le site de France Culture.
Les commentaires sont tout à fait chaleureux (je cite) :
« Reprise de la production déléguée Théâtre National Populaire
Production Théâtre Gérard Philipe – centre dramatique national de Saint-Denis
Spectacle créé le 23 mars 2019 au Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis.
C‘est naturellement la traduction d’André Markowicz qui a été choisie par Jean Bellorini. André Markowicz est un complice de longue date mais c’est surtout la qualité et la beauté de la traduction qui a déterminé ce choix. S’il a mis près de vingt-huit ans à traduire les cinq mille cinq cent vingt-trois vers de ce roman, c’est parce qu’il s’est employé à transmettre le plus fidèlement possible la métrique russe, en suivant les accents rythmiques, pour rapprocher le vers syllabique français du vers russe, syllabo-tonique. Il a ainsi réussi à transmettre la beauté essentielle de l’œuvre. Et c’est ainsi qu’il parle de l’œuvre dans Partages : “ Je le dis souvent : une fois qu’on est entré dans Onéguine, qu’on a, non pas “compris” (il n’y a rien à comprendre, pas de sens caché, rien – tout est à la surface), mais “senti”, alors, vraiment, votre vie change, et vous vivez dans ce sourire, ce sourire d’une tristesse infinie, mais dont émane une lumière étonnante : quelque chose d’intime (je veux dire que ça parle à chacun de nous différemment, selon sa vie, son enfance, ses propres souvenirs) et de totalement universel. Et, je le redis, léger.” »
Et, chose rare, on donne la parole au traducteur pour un long entretien (qui peut s’écouter en ligne).
Mieux que d’un article, il faudrait parler d’un essai d’Yves Di Manno sur Armand Robin à l’occasion de la parution de la synthèse actualisée de ma thèse chez Garnier en décembre dernier, Armand Robin ou le mythe du Poète. Pour la première fois, mon entreprise d’édition est comprise pour ce qu’elle était : une manière de donner la parole à un écrivain qui avait choisi de faire de la poésie autrement, sans séparer poésie et traduction – une entreprise d’édition vouée à l’échec, comme l’expérience de Robin lui-même, pour des raisons qui sont en soi révélatrices : le mythe, apte à agglomérer n’importe quoi dès lors que les données de bases sont assemblées, l’emporte inéluctablement, laminant les faits qui n’entrent pas dans le cadre prévu, les textes de l’auteur qui le dérangent, les démonstrations, fussent-elles faites dans le cadre universitaire le plus rigoureux, et en présence de l’éditeur qui a le devoir moral de respecter les textes.
Si Robert Gallimard avait compris cette entreprise, depuis sa disparition, elle a sombré, enlisée sous les lieux communs constitutifs du mythe triomphant. Tenter de l’analyser ne sert pas tout à fait à rien puisque, discrètement, une compréhension nouvelle se fait jour. Enfin une lumière dans ces épaisses ténèbres… L’essai d’Yves Di Manno est paru dans le numéro 29 de la revue Catastrophes (titre adéquat dans le cas de Robin) et il a eu la gentillesse de me l’adresser en PDF. Qu’il en soit chaleureusement remercié !