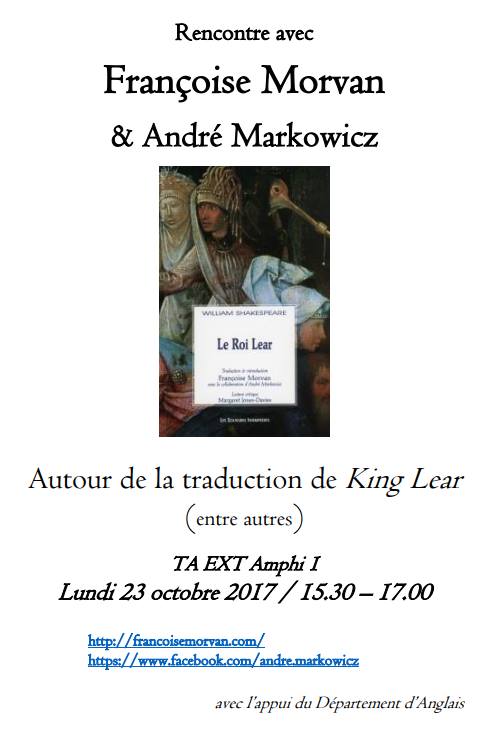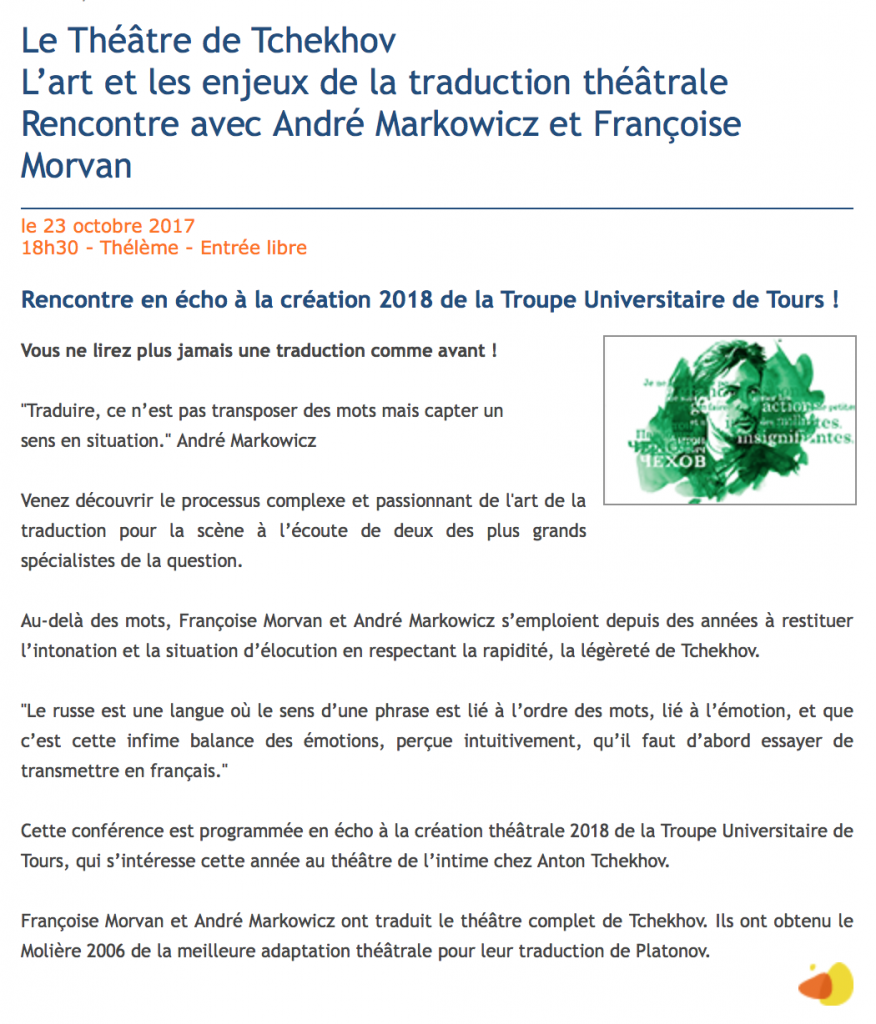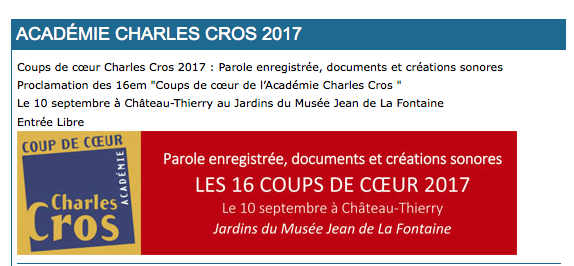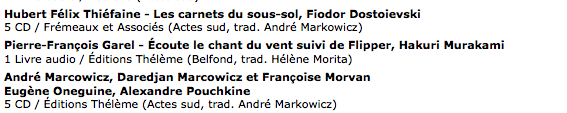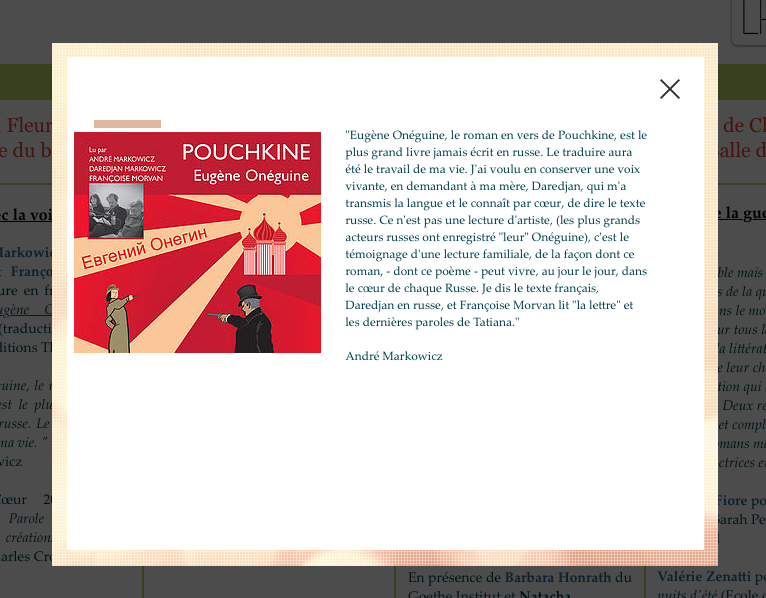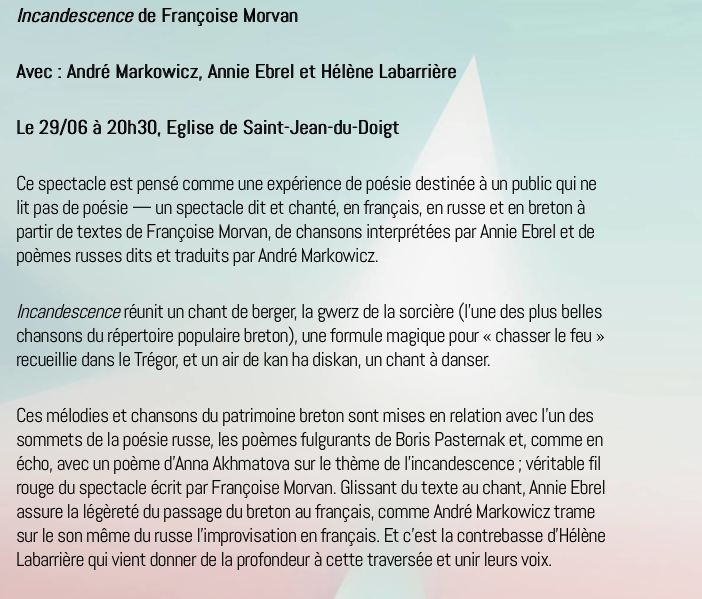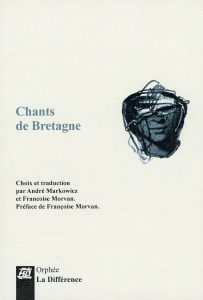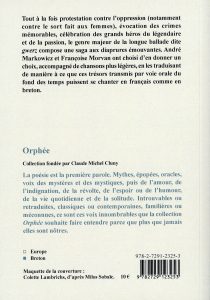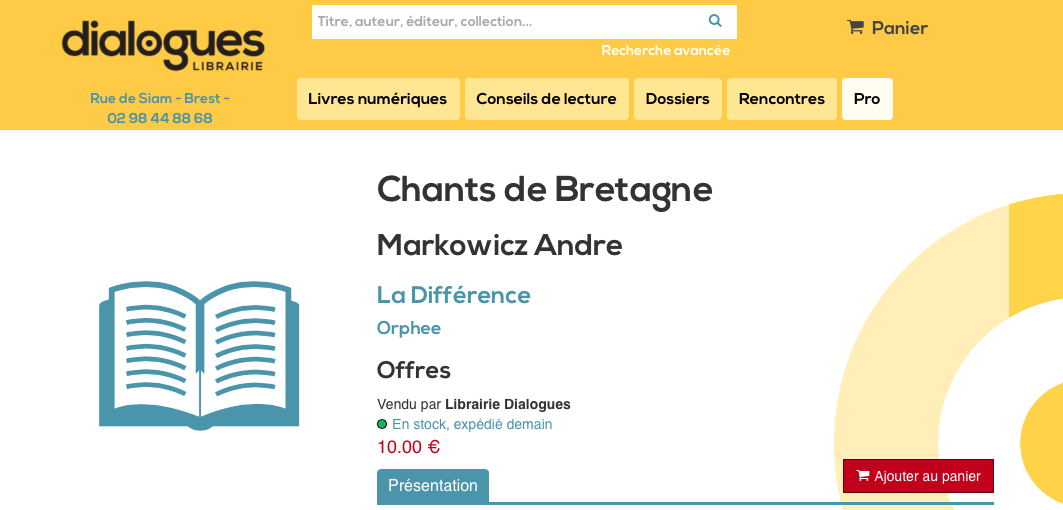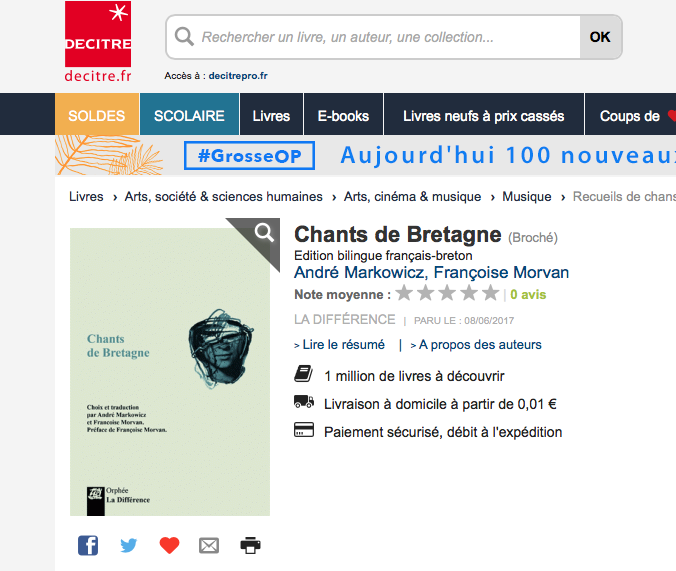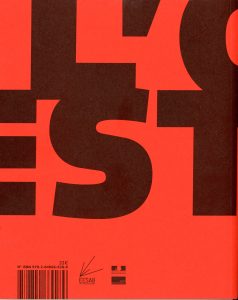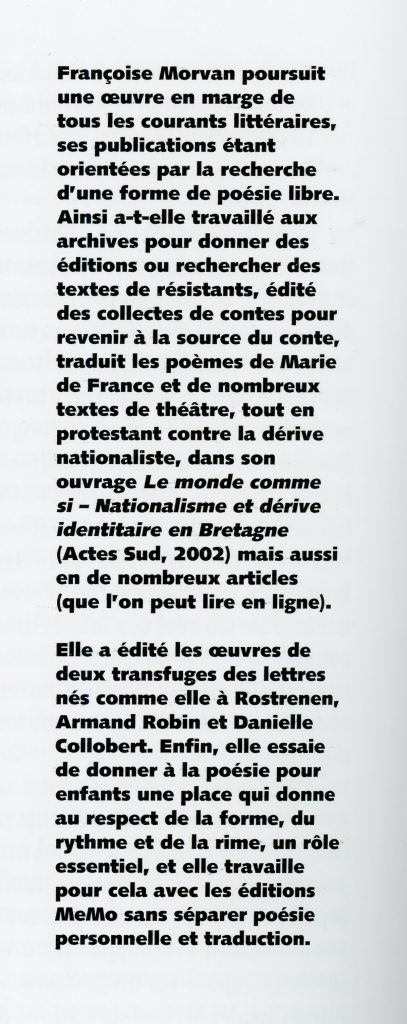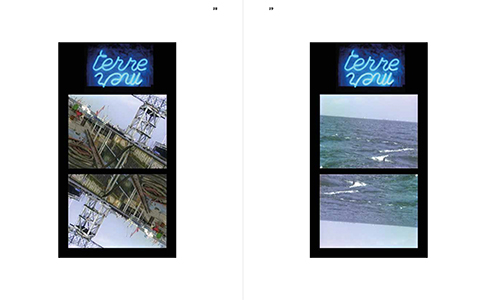Ils ont tenu !
.Le vent soufflait en bourrasque, la pluie menaçait et, par moments, l’orage grondait : on aurait cru qu’il sortait des poèmes de Boris Pasternak et qu’Anne Auffret l’apaisait de la harpe, juste le temps qu’il se calme un peu et n’emporte pas la scène. C’était hier devant la chapelle de Saint-Antoine en Lanrivain ; nous donnions l’unique représentation d’Enfance — unique, à moins qu’il ne se trouve un endroit où le reprendre, comme ç’a été le cas pour Incandescence l’an passé. Un spectateur a fait observer que c’était un spectacle d’intérieur et il avait raison, même si le fait de jouer comme en suspens sur le vent devant la vallée donnait une impression d’enfance prête à s’envoler elle aussi, ce qui était bien le thème du spectacle.
Bref, tout s’est bien passé : plus de trois cents spectateurs (le plus grand nombre d’entrées pour les spectacles du festival Lieux mouvants, m’a-t-il été dit). Et pourtant, nous étions en concurrence avec la Saint-Loup et ses festivités, le week end du vélo breton, l’exposition de véhicules refroidis par air à Guiscriff, l’opération promotion de l’Office de tourisme du Kreiz Breizh à Bon-Repos, la course cycliste de Kreiz Breizh élite, les randonnées de l’électrothèque de Guerlédan, le match de cricket de Silfiac, le pardon de saint Ignace à Saint-Aignan, la kermesse de l’AIKB à Gouarec, sans compter nombre de fest deiz, rencontres sportives et braderies troc et puces. On peut dire que les personnes qui sont venues écouter de la poésie au risque de repartir trempées l’ont fait par choix. Et ce d’autant que les médias n’avaient consacré que deux lignes à l’annonce, en oubliant Anne et en remplaçant Frédérique par Hélène, la contrebassiste qui intervenait l’an passé. On ne peut qu’être reconnaissants à ceux qui sont venus si nombreux.
.

Les premiers spectateurs et la scène au bord de s’envoler
C’est bien d’ailleurs l’événement essentiel, et les rencontres après le spectacle se sont prolongées jusque tard le soir avec des auditeurs qui venaient parfois de loin.
Le spectacle était très risqué car mes poèmes sous leur apparence simple étaient assez complexes, André avait la charge de passer du français au russe, Anne et Annie devaient chanter les chansons en breton et en français — expérience nouvelle qui pouvait tout à fait échouer, mais elles ont, au contraire, donné l’impression que ces anciennes chansons passaient avec une fluidité naturelle d’une langue à l’autre, comme André du russe au français, et c’est cette circulation fluide des thèmes et des langues qui assurait le passage des images d’enfance, à la fois nette et floues, perdues dans un rêve mais immédiates comme les images des chansons.

Anne Auffret, Annie Ebrel et André Markowicz retenant son texte à deux mains
L’idée d’Annie de faire appel à Frédérique et au marimba pour assurer cette impression de fluidité était vraiment lumineuse, et la harpe d’Anne venait apporter l’exact contrepoint attendu pour des textes et des chansons écrits en miroir, et parfois traduits, ou non traduits, en miroir. D’autant que les voix d’Anne et d’Annie se répondent et se complètent admirablement.

Frédérique Lory, une marimbiste dans le vent
.
Nul n’aurait pu penser qu’elles luttaient contre la bourrasque et le spectacle s’est terminé dans une sorte de lumière d’avant la pluie qui était comme un miracle de sérénité.
*
Autre miracle, à notre grande surprise, pour la première fois depuis plus de vingt ans, la presse locale a relayé l’événement en mentionnant mon nom et en donnant un véritable article. Merci à Manon Thépault, la jeune journaliste qui nous a interrogés.
.
Les photographies qui illustrent cet article sont dues à Oliver Troël qui en possède le copyright.